Transferts en souffrance
Enquête pour déterminer si le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé prennent des mesures adéquates pour intervenir dans l’hospitalisation indue des adultes ayant une déficience intellectuelle

Table des matières
Affichez
Masquez
Transferts en souffrance
Enquête pour déterminer si le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé prennent des mesures adéquates pour intervenir dans l’hospitalisation indue des adultes ayant une déficience intellectuelle
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
Novembre 2025
Conférence de presse
Rapport
Reconnaissance des territoires
Ombudsman Ontario reconnaît que la province de l’Ontario se trouve sur les territoires de plus de 130 Premières Nations, dont chacune se distingue par ses cultures, ses langues et son histoire, beaucoup plus anciennes que la province et ses frontières.
Nous reconnaissons l’existence sur ces territoires de confédérations politiques, comme la Confédération des Trois Feux et la Confédération Haudenosaunee, qui ont précédé dans le temps la création du Canada et de l’Ontario et sont liées entre elles par des traités et des relations qui dynamisent le paysage de la province.
Nous reconnaissons humblement les responsabilités et obligations collectives qui nous incombent aux termes des plus de 40 traités qui existent en Ontario, dont le Traité no 3, le Traité no 9, les traités Robinson-Supérieur et Robinson-Huron et les Traités Williams.
Nous reconnaissons que les peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres pendant des millénaires ont été dépossédés par la colonisation, et nous voulons trouver des façons de redresser les torts historiques et actuels.
Nous sommes reconnaissant(e)s de pouvoir parcourir ces territoires en Ontario et y travailler avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits depuis la création de l’Ombudsman il y a 50 ans.
Ombudsman Ontario s’est engagé à nouer des liens respectueux avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans la province en misant sur la confiance et la transparence, afin de pouvoir leur fournir plus de services et partager avec ces gens et ces communautés un avenir meilleur.
Contributeur(trice)s
Directrice, équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman
- Domonie Pierre
Enquêteuse principale
- Yvonne Heggie
Enquêteur(euse)s
- Armita Bahador
- Chris McCague
- Emily Ashizawa
- Emily Dutil
- Richard Francis
- Rosie Dear
- Sonia Tran
Agente de règlement préventif
- Rosemary Bowden
Avocates générales
- Joanna Bull
- Laura Pettigrew
Avocat(e)s
- Ethan Radomski
- Iris Graham
Sommaire analytique
1 Dans un article publié en 1960, le journaliste et auteur Pierre Berton décrivait les faits troublants qu’il avait constatés lors d’une visite au Centre régional de la Huronie, à Orillia. Le texte appelait haut et fort à une réforme du système ontarien de soins en établissement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Il concluait sur ces mots qui font froid dans le dos [Traduction] : « Ne dites pas que vous ignoriez la situation derrière ces murs de plâtre, sous ces plafonds de bois écaillés. »
2 Dans les décennies qui ont suivi, la société a répondu en promettant une désinstitutionnalisation, en reconnaissance de la dignité et des droits inhérents aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Les gouvernements se sont engagés à fermer les établissements et à les remplacer par des ressources communautaires qui permettraient à ces personnes de vivre de manière autonome et dans la dignité.
3 Cependant, malgré la fermeture des établissements comme celui de la Huronie, la réalité est qu’il a été difficile d’honorer cette promesse. Le manque de logements et de services appropriés a laissé beaucoup de gens sans le soutien nécessaire, ce qui a mené à une forme moderne d’institutionnalisation par défaut. Aujourd’hui, même si les personnes ayant une déficience intellectuelle ne sont plus délibérément placées en milieu institutionnel, le système surchargé et en pénurie de ressources se traduit par un manque d’options viables, et certaines personnes – surtout celles ayant des besoins particuliers – se retrouvent à être placées à l’hôpital ou dans un autre milieu inapproprié.
4 En août 2016, j’ai publié Dans l’impasse, un rapport sur les résultats de mon enquête sur la réponse du ministère des Services sociaux et communautaires (ainsi nommé à l’époque) aux situations de crise vécues par des adultes ayant une déficience intellectuelle. J’ai constaté qu’en raison des soutiens et des services communautaires limités, « [f]ace à une telle impasse, les personnes en situation de crise peuvent donc se trouver hébergées dans des établissements inappropriés, allant des hôpitaux aux prisons ».
5 J’ai adressé 60 recommandations au Ministère pour qu’il résout les enjeux systémiques dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Cinq d’elles portaient spécifiquement sur l’institutionnalisation par défaut des adultes ayant une déficience intellectuelle dans les hôpitaux généraux et les établissements psychiatriques de l’Ontario.
6 Nous avons suivi de près les progrès du Ministère dans la mise en œuvre de mes recommandations, puisque nous recevions toujours des plaintes. Au fil du temps, certaines améliorations ont été apportées, mais des familles et des professionnel(le)s inquiet(ète)s nous signalaient toujours des cas d’adultes ayant une déficience intellectuelle indûment hospitalisé(e)s, parfois pendant des années. On nous a dit que dans les hôpitaux, certaines personnes étaient souvent contrôlées au moyen de contentions chimiques et physiques, et que dans bien des cas, leur état s’était détérioré pendant leur long séjour à l’hôpital.
7 Des personnes ayant une déficience intellectuelle dépérissent en milieu hospitalier en raison d’enjeux systémiques qui se recoupent dans les secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En mars 2023, j’ai décidé de lancer une nouvelle enquête visant le Ministère, qui est maintenant le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, ainsi que le ministère de la Santé, afin de déterminer s’ils prenaient des mesures adéquates pour assurer à ces personnes des logements et des soutiens communautaires appropriés.
8 Le présent rapport résume l’histoire de sept personnes[1] en séjour prolongé et non nécessaire à l’hôpital, attendant depuis des mois, voire des années, pour accéder à des options convenables de logement et de soutien :
- Jordan, 25 ans, a passé 15 mois à l’hôpital, effrayé et parfois immobilisé dans un environnement bruyant et imprévisible.
- Jack, 57 ans, a vécu à l’hôpital pendant plus de huit ans, avant d’être finalement placé en foyer trois mois avant son décès.
- Luc, 30 ans, un Franco-Ontarien, a été hospitalisé pendant plus de quatre ans, souvent sans accès à des soins et des services en français, et régulièrement immobilisé par des contraintes mécaniques et chimiques. Il est brièvement retourné dans sa communauté avant de retourner à l’hôpital, où il demeure encore à ce jour.
- Noah, 22 ans, a été attaché à son lit et mis sous sédatifs pendant la majorité de son séjour de plus de deux ans à l’hôpital.
- Sean, 27 ans, a vécu dans un hôpital psychiatrique médicolégal pendant cinq ans, physiquement immobilisé durant parfois 20 heures par jour, avant de déménager dans un logement avec services de soutien.
- Kevin, 27 ans, a été hospitalisé pendant plus de deux ans, parfois immobilisé ou isolé, avant d’emménager dans un foyer communautaire.
- Anne, 59 ans, souhaitait ardemment quitter l’hôpital, mais y est restée coincée pendant plus de deux ans.
9 Pendant leur hospitalisation, toutes ces personnes ont vécu une forme de régression, perdu des aptitudes à la vie quotidienne ou vu leurs fonctions physiques et mentales se détériorer. Le déclin de leur état a restreint encore plus les possibilités de trouver un foyer communautaire et un organisme de services prêt et disposé à répondre à leurs besoins.
10 En tant qu’Ombudsman, j’ai la responsabilité de faire [Traduction] « la lumière dans des coins sombres, même en dépit de ceux qui préféreraient tirer le rideau[2] ». Dans le présent rapport, comme Pierre Berton l’a fait à sa manière il y a 65 ans, j’ai ouvert les rideaux et révélé un aperçu de la vie de sept personnes particulièrement vulnérables dont la dignité, l’intégrité, la liberté et la qualité de vie ont été compromises dans un milieu institutionnel n’ayant jamais été conçu pour répondre à leurs besoins.
11 Malheureusement, ces histoires ne sont pas uniques. Elles laissent entrevoir un plus vaste problème, comme le montrent les multiples plaintes reçues au sujet de personnes dans des situations semblables. Nous savons que d’autres personnes en Ontario sont confinées à leur lit d’hôpital en attendant une place dans la communauté. Nous n’avons pas de données précises et exhaustives concernant le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont indûment hospitalisées en Ontario, le nombre de personnes attendant une place avec services de soutien, le délai d’attente moyen pour ces places ou le nombre de personnes placées chaque année. Les données disponibles sont incohérentes et rarement accessibles au public. Les documents du MSESC montrent que près de 30 000 Ontarien(ne)s ayant une déficience intellectuelle sont inscrit(e)s pour une place avec services de soutien financée par le Ministère. D’après les dossiers du ministère de la Santé, des dizaines de personnes se trouveraient en milieu hospitalier en attendant une place dans un établissement communautaire, mais selon une étude d’octobre 2024 réalisée par l’Institute for Clinical Evaluative Sciences et le Centre de toxicomanie et de santé mentale[3], ce nombre pourrait avoisiner les centaines.
12 Je présente 24 recommandations pour améliorer la disponibilité et la transparence des soutiens et des services destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et ayant besoin de soins complexes. J’exhorte les deux ministères à combler le fossé entre les secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à collaborer pour mettre en œuvre des solutions intégrées et à réaliser une planification proactive du système pour réduire le nombre d’hospitalisations inappropriées.
13 Cette enquête vient aussi confirmer que d’importantes recommandations de mon rapport de 2016, Dans l’impasse, n’ont pas encore été appliquées. J’ai espoir que ce nouveau rapport sera un catalyseur qui incitera les deux ministères à faire équipe afin de résoudre ces enjeux systémiques. Je suivrai leurs progrès de près.
Le processus d’enquête
14 Cette enquête portait sur les expériences de personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont été hospitalisées de longues périodes dans l’attente d’un logement et de services de soutien appropriés qui leur permettraient de vivre sécuritairement dans la collectivité. Nous nous sommes penché(e)s sur les obstacles empêchant les transitions en temps opportun hors de l’hôpital ainsi que sur les mesures adoptées par les ministères concernés pour résoudre ces problèmes.
15 Entre avril 2020 et le lancement de l’enquête le 27 mars 2023, nous avons reçu 15 plaintes concernant des personnes ayant une déficience intellectuelle dépérissant à l’hôpital, parfois depuis des années, sans pouvoir entrevoir la fin de leur séjour. Depuis le début de cette enquête, nous avons reçu plus de 40 autres plaintes concernant des gens dans des situations aussi difficiles. Dans le présent rapport, nous faisons état de sept cas qui illustrent les enjeux complexes et les problèmes humains vécus par ces personnes.
16 Au cours de cette enquête, nous avons rencontré plus de 120 personnes, dont des personnes hospitalisées et des membres de leur famille, des membres du personnel hospitalier et clinique, des organismes de services, des membres du personnel des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des représentant(e)s d’organismes communautaires et de défense des droits. Nous avons aussi parlé avec du personnel de première ligne et des haut(e)s fonctionnaires du ministère de la Santé, du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et de Santé Ontario. De plus, nous avons examiné des milliers de documents fournis par ces ministères et par tous ces gens rencontrés et mené des recherches additionnelles.
17 Nous continuons d’examiner les plaintes individuelles et de demander des renseignements aux fonctionnaires dans le but de résoudre les problèmes lorsque c’est possible. Malheureusement, cette tâche s’avère souvent difficile à cause des obstacles systémiques décrits dans le présent rapport.
Survol de la législation
18 Pendant plus d’un siècle, l’Ontario a exploité des établissements isolés réservés aux personnes ayant une déficience intellectuelle[4], [5]. Dans les années 1970, ces services passent graduellement d’un modèle médical et institutionnel à un modèle communautaire. En 1974, la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle[6] entre en vigueur, établissant un cadre pour la création, le financement et la prestation de services communautaires destinés à ces personnes. De plus, elle transfère la responsabilité des 16 établissements ontariens, jusque-là exploités par le ministère de la Santé, au ministère des Services sociaux et communautaires. En 1977, la province lance un plan pour multiplier les ressources communautaires et réduire le recours aux soins en établissement.
19 Aujourd’hui, la prestation de ces services et de ces soutiens en Ontario est régie par la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle[7]. Cette loi a été créée pour moderniser les services, offrir plus d’autonomie et de choix, faciliter la transition vers un modèle communautaire et renforcer l’inclusion sociale. Elle visait aussi à accroître l’équité et l’uniformité des critères d’admissibilité, des évaluations et de l’accès aux services et à simplifier le processus d’accès aux soutiens, aux services et au financement.
20 La loi actuelle prévoit la désignation d’« entités d’examen des demandes » servant de points d’accès uniques aux services et soutiens dans chaque zone géographique de la province. Elle renferme aussi des dispositions prévoyant la création d’« entités d’examen du financement », lesquelles ne sont toutefois jamais entrées en vigueur.
21 En 2021, le gouvernement a publié une vision ambitieuse de réforme à long terme des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, appelée En quête d’appartenance : Choix et inclusion. Ce document imagine un avenir où les collectivités, les réseaux d’aide et le gouvernement aident les personnes ayant une déficience intellectuelle pour qu’elles « bénéficient des moyens de faire leurs propres choix et de vivre de la façon la plus autonome possible grâce à des dispositifs de soutien gérés par la personne, équitables et pérennes[8] ». Cette vision met aussi l’accent sur la planification proactive et l’intégration des soutiens avec d’autres secteurs.
Services et soins de santé aux personnes ayant une déficience intellectuelle
22 Les adultes ayant une déficience intellectuelle peuvent être admis(es) à l’hôpital pour des raisons médicales. Mais une fois que les soins actifs ne sont plus nécessaires, certaines personnes restent parce que la famille ou l’organisme ne peut plus s’en occuper. D’autres n’ont pas besoin de soins médicaux, mais se retrouvent à l’hôpital parce qu’il n’y a tout simplement aucun autre endroit pouvant leur fournir les services et les soutiens dont elles ont besoin.
23 Dans certains cas, les hôpitaux classent ces personnes comme des patient(e)s « nécessitant un autre niveau de soins », une expression qui signifie que la personne occupe un lit à l’hôpital alors qu’elle n’a pas besoin de soins actifs. D’autres personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont en hébergement « de longue durée » ne sont pas catégorisées officiellement comme des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins, mais demeurent à l’hôpital seulement parce qu’il n’y a pas de place avec services de soutien dans la communauté qui puisse leur convenir. Comme je l’avais noté dans mon rapport Dans l’impasse, le secteur hospitalier s’inquiète depuis longtemps de l’utilisation pour ces patient(e)s de ressources médicales limitées[9].
24 Les adultes ayant une déficience intellectuelle qui sont hospitalisé(e)s pour de longs séjours se retrouvent dans deux systèmes distincts : les soins de santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
25 Dans le présent rapport, j’emploie le mot « système » pour désigner ces groupements de programmes et de services. Cependant, les « systèmes » dont on parle ne présentent pas nécessairement la structure interreliée, organisée et stratégiquement planifiée qui devrait les caractériser lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle. Certains programmes et services sont fournis de manière ponctuelle et réactive et varient selon l’endroit. Le niveau de coordination et de communication entre les soins de santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle n’est pas toujours le même auprès des personnes qui nécessitent une transition dans la collectivité.
Survol du système
26 Quand une personne ayant une déficience intellectuelle reste à l’hôpital parce qu’il n’y a pas d’option communautaire adéquate, il faut traverser tout un labyrinthe d’organismes et de processus pour lui trouver les soutiens et le logement dont elle a besoin. Un bon plan de transition repose habituellement sur la collaboration entre ces entités et sur l’obtention de fonds suffisants.
27 Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC) et le ministère de la Santé (MSAN) ont tous deux des responsabilités à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle, chacun dans le cadre de leur mandat respectif. Le MSESC planifie, finance et encadre le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, tandis que le ministère de la Santé voit à la gestion efficace des services de soins de santé, dont les hôpitaux. Le ministère de la Santé a notamment pour rôle de s’assurer que les gens peuvent accéder « [aux] bons soins au bon endroit[10] ».
28 Les adultes souhaitant obtenir des services financés par le MSESC doivent présenter une demande, être jugés admissibles et être inscrit(e)s auprès des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI), le point d’accès aux services de logement et de soutien financés par l’État. Les SOPDI comptent neuf bureaux régionaux chargés d’examiner les demandes et de vérifier l’admissibilité aux services financés par le MSESC. Ces bureaux orientent les personnes admissibles vers les services disponibles et tiennent des registres pour les services demandés, tels que le logement avec services de soutien, les soutiens à la participation communautaire et les services de relève de courte durée. Parmi les services de logement avec soutien financés par le MSESC, il y a les foyers de groupe, les familles d’accueil, l’aide à la vie autonome, les foyers avec services de soutien intensif et l’hébergement spécialisé. Le niveau de soutien offert, dont le personnel à disposition, dépend du type de logement choisi. En général, les foyers avec services de soutien intensif et l’hébergement spécialisé offrent un personnel de soutien 24 heures sur 24 et, parfois, un accès à du soutien clinique pour les personnes ayant des besoins complexes ou un diagnostic mixte (c’est-à-dire un diagnostic de déficience intellectuelle et de trouble de santé mentale).
29 Une fois inscrite auprès des SOPDI, la personne doit souvent attendre longtemps avant de pouvoir obtenir des services et un logements adapté financé par le Ministère, car la demande excède largement l’offre. Pour cette raison, les SOPDI utilise un algorithme pour prioriser l’accès aux services financés en fonction du niveau de risque de la personne, dont le risque d’itinérance. Ainsi, la priorité pourrait être accordée à une personne qui dépérit à l’hôpital ou qui risque d’être autorisée à sortir alors qu’elle n’a nulle part où aller. Il est donc important que ces hospitalisations soient signalées aux SOPDI. Les SOPDI peuvent également aiguiller les personnes ayant des besoins complexes ou multiples vers des gestionnaires de cas ou des services développementaux ou comportementaux le temps de leur séjour à l’hôpital. Ce type de soutien est souvent essentiel pour faciliter la communication entre la personne (avec qui il n’est pas toujours possible d’interagir verbalement) et le personnel hospitalier. Il peut aussi contribuer à amoindrir la perte d’aptitudes et faciliter la préparation de plans de transition.
30 S’il est impossible de fournir à la personne des services ou un placement financés répondant à ses besoins, ce qui est souvent le cas, les SOPDI peuvent soumettre le dossier à un comité de planification communautaire. Ces comités regroupent des organismes de services financés par le MSESC, parfois des représentant(e)s du MSESC, et potentiellement d’autres partenaires du secteur, comme des professionnel(le)s de la santé.
31 Les organismes de services siégeant au comité de planification examinent les dossiers urgents et prioritaires pour déterminer s'ils disposent des ressources appropriées et disponibles, notamment des logements supervisés ou d'autres formes de soutien. Ces organismes ont le pouvoir discrétionnaire de décider d'apporter ou non leur aide à une personne. Ils peuvent le faire seuls ou en collaboration avec d'autres organismes et services. Pour les personnes ayant besoin d’un soutien intensif et de soins complexes, les réseaux communautaires de soins spécialisés peuvent faire équipe avec la personne, les organismes et le comité de planification pour faciliter la coordination entre les systèmes de services, dont le système des soins de santé et le système des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
32 Même si un placement est disponible, un financement supplémentaire est souvent nécessaire pour couvrir les aménagements physiques et autres mesures de soutien permettant aux personnes ayant une déficience intellectuelle de vivre en toute sécurité et de manière autonome dans la collectivité. Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)[11] ou le programme Passeport[12], auxquels ces personnes peuvent être admissibles, ne sont pas destinés à l’achat ou à la rénovation de logements et sont souvent insuffisants pour couvrir les coûts d’embauche de personnel de soutien direct pour celles qui nécessitent un soutien à temps plein et un ratio de soutien plus élevé. Les coûts peuvent s’élever à des centaines de milliers de dollars par année, voire dépasser le million pour les personnes ayant des besoins particulièrement élevés.
33 Le MSESC prévoit des fonds limités pour accroître les ressources destinées aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans le cadre du programme pluriannuel des services de soutien, il peut attribuer des fonds annuellement à certaines personnes prioritaires dans chaque région. Il s’agit souvent de personnes se trouvant dans un milieu inadéquat, comme un hôpital ou un refuge; les fonds les aident à payer le logement ou d’autres services dont elles ont besoin pour vivre de façon sécuritaire dans son milieu.
34 En plus du financement fourni par ce programme pluriannuel, de 2021 à 2023, le MSESC et le MSAN ont financé conjointement un projet visant à faciliter la sortie d’hôpital des personnes à diagnostic mixte. Ce projet, appelé le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, était le fruit d’une collaboration entre les deux ministères, Santé Ontario et les bureaux régionaux du MSESC. Le financement, qui était limité, était réservé aux personnes retenues et jugées hautement prioritaires pour l’accès aux services, de même qu’à celles ayant une déficience intellectuelle et un diagnostic officiel de trouble de santé mentale (diagnostic mixte).
35 Parfois, les travailleur(euse)s sociaux(ales) des hôpitaux ou un(e) gestionnaire de cas peuvent trouver un placement privé si la personne peut se le permettre financièrement ou se le faire payer par l’État. Certaines personnes peuvent être logées dans un foyer avec services de soutien financé par le MSAN qui offre des places répondant à leurs besoins, quoique les délais d’attente soient souvent longs, sans compter que ces foyers ne conviennent pas toujours aux personnes ayant des besoins complexes.
36 D’autres peuvent avoir besoin de soutien clinique pour passer de l’hôpital à la collectivité, comme des services psychiatriques ou infirmiers. D’autres encore doivent suivre des traitements spécialisés, par exemple un programme hospitalier à durée déterminée pour les personnes à diagnostic mixte qui ont des problèmes comportementaux. Les gestionnaires de cas, les coordonnateur(trice)s de cas complexes ou les membres du personnel hospitalier peuvent alors intervenir pour aiguiller la personne ou l’organisme vers ces services.
37 Santé Ontario est un organisme public dont la mission est de « connecter, coordonner et moderniser » le système de santé[13]. Ses objectifs comprennent la promotion de « l’intégration des services de santé afin de permettre une prestation de services appropriée, coordonnée et efficace »[14]. Santé Ontario a précisé que, dans le cadre de ce rôle, l’organisme supervise la prise en charge de toutes les populations hospitalisées nécessitant un niveau de soins différent, notamment les personnes ayant une déficience intellectuelle. Il incombe aux hôpitaux de rapporter à Santé Ontario les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins, car le nombre de places occupées par des personnes n’ayant plus besoin de soins a un impact sur l’accès des autres à des soins en temps opportun. Les hôpitaux peuvent aussi dire à Santé Ontario si la personne occupant un lit affecté à un autre niveau de soins doit rester à l’hôpital parce qu’elle a [Traduction] « besoin de services pour personnes ayant une déficience intellectuelle[15] ». Malheureusement, comme notre enquête l’a révélé, les chiffres ne sont pas toujours fiables.
Vies suspendues : histoires racontées depuis l’hôpital
38 Les sept histoires racontées dans le présent rapport illustrent les épreuves souvent vécues par les adultes ayant une déficience intellectuelle, surtout ceux(celles) ayant des besoins complexes, lorsqu’ils(elles) se retrouvent coincé(e)s à l’hôpital, n’ayant nulle part d’autre où aller.
39 Les cas que nous documentons incluent des périodes d'hospitalisation survenues pendant la pandémie de COVID-19. Si, dans certains cas, la pandémie a aggravé des problèmes de santé empêchant une sortie d'hôpital rapide, elle n'explique pas entièrement ces retards. Les obstacles systémiques à l'origine d'hospitalisations inappropriées et de l'impossibilité d'accéder à des services adaptés et à un logement adapté existaient bien avant la pandémie et ont persisté après sa fin.
40 Ces sept personnes ne sont pas les seules dans cette situation. Nous continuons d’entendre des familles et des professionnel(le)s qui s’inquiètent pour des gens dans des situations semblables. En décembre 2024, Santé Ontario rapportait que 124 adultes ayant une déficience intellectuelle se trouvaient à l’hôpital alors qu’ils(elles) n’avaient plus besoin de soins médicaux actifs. Et le compte n’est pas exhaustif. Les hôpitaux ne reconnaissent pas et ne signalent pas toujours qu’un(e) patient(e) a une déficience intellectuelle, et différentes raisons peuvent expliquer pourquoi ils ne déclarent pas une personne comme nécessitant un autre niveau de soins même si celle-ci reste à l’hôpital uniquement parce qu’aucune autre option ne convient.
41 Les histoires suivantes montrent comment sept membres particulièrement vulnérables de notre société ont inutilement langui dans les hôpitaux, dans l’attente interminable d’un placement dans leur communauté. Malgré toute la compassion et la bienveillance dont peut faire preuve le personnel hospitalier, un hôpital n’est pas un chez-soi.
Un cercle vicieux : l’histoire de Jordan
42 Jordan, un jeune homme de 25 ans qui aime passer du temps en famille, a résidé 15 mois à l’hôpital en attendant un placement approprié dans la collectivité. Il a un trouble autistique, une infirmité motrice d’origine cérébrale, des troubles obsessionnels-compulsifs et certains troubles affectant son cœur et son foie. Il ne peut pas communiquer verbalement et utilise une tablette pour se faire comprendre. Il a aussi besoin d’aide dans des tâches quotidiennes comme utiliser la toilette, se laver et se brosser les dents. Alors qu’il était auparavant un jeune homme heureux, son comportement s’est détérioré durant la pandémie de COVID-19. Il est devenu si agressif et violent qu’il ne pouvait plus rester chez lui.
43 Vu l’intensification des crises de Jordan à la maison, sa mère ne pouvait plus travailler. Elle nous a avoué être devenue si désespérée qu’à un certain point, elle se disait que la seule façon de redonner à son mari et à son autre fils leur vie normale serait de tuer Jordan et de se tuer elle. En l’absence de soutien suffisant, elle sentait qu’« il n’y avait aucune solution... aucune aide. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel ». Quand Jordan a essayé d’étrangler sa tante pendant que sa mère faisait des courses, la famille a dû appeler le 9-1-1, et alors Jordan a été admis à l’hôpital.
44 À l’unité des soins psychiatriques intensifs, Jordan avait peur, et son comportement était souvent exacerbé par les cris des autres patient(e)s en crise. Au début, il n’avait pas accès au personnel d’aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle et, comme l’ont exposé ses parents, vu qu’il n’avait pas toujours sa tablette, il peinait à indiquer au personnel hospitalier ses besoins de base. Par moments, il restait couché dans des draps imbibés d’urine.
45 L’hôpital nous a expliqué que les ratios en personnel ne permettaient pas de donner à Jordan le niveau de soins nécessaires. Il a aussi reconnu que l’unité des soins psychiatriques intensifs était un environnement extrêmement difficile pour une personne sur le spectre de l’autisme comme Jordan : il n’y a pas de routine, le personnel infirmier change souvent, et il n’est généralement pas formé pour communiquer avec les personnes autistes. Initialement, comme le personnel était mal outillé pour gérer son comportement, Jordan était immobilisé physiquement par des attaches au lit ou chimiquement par des sédatifs. Ses parents ont dit devoir passer parfois 12 heures à l’hôpital par jour pour s’occuper des besoins de base de leur fils.
46 La mère de Jordan a dit qu’ils se sentaient coincés dans une « sorte de boucle sans fin ». Elle a rapporté que les organismes de services semblaient indisposés à travailler avec Jordan parce qu’il était « trop violent », tandis que les programmes de traitement privés potentiellement en mesure de traiter ce comportement agressif le refusaient parce qu’il n’aurait pas d’endroit où vivre à la fin. Jordan était dans un cas classique de cercle vicieux : sans les soins, il ne pouvait obtenir de logement, et sans logement, il ne pouvait obtenir de soins.
47 Même si Jordan était un cas hautement prioritaire pour les Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, aucune place disponible ne répondait à ses besoins, et les fonds ministériels ne permettaient pas d’obtenir le ratio en personnel nécessaire de deux pour un. C’est seulement lorsqu’il y a eu un décès qu’une place s’est libérée dans la collectivité. Jordan a alors été choisi pour recevoir des fonds du projet ministériel conjoint d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic. Il a emménagé dans son nouveau logement le 7 novembre 2023, soit 15 mois après son admission à l’hôpital. Jordan va maintenant « super bien » dans son logement et voit régulièrement ses parents et son frère.
« Sortez-moi d’ici » : l’histoire de Jack
48 Jack a grandi dans sa communauté avec sa famille et adorait tout ce qui concernait les autos. Il avait un diagnostic de schizophrénie réfractaire et des difficultés à l’école, et n’avait jamais appris à lire. Pourtant, jamais en cinquante ans il n’avait été désigné comme une personne ayant une déficience intellectuelle et n’avait reçu les soutiens et services associés.
49 Durant sa vie adulte, Jack est passé d’un lieu d’hébergement inapproprié à un autre. Quand il n’était pas surveillé de près, il buvait tant de liquide qu’il pouvait parfois subir une crise se soldant par un séjour à l’hôpital. Incapable de s’occuper de lui-même et n’ayant nulle part d’autre où aller, Jack a fini par passer plus de huit ans à l’hôpital. Il nous a dit qu’il n’avait pas sa place à l’hôpital et sentait que personne ne l’aidait.
50 Il a aussi exprimé sa frustration de n’avoir aucun contrôle sur ses activités quotidiennes, y compris des choses aussi simples que choisir le moment de prendre sa douche. Il s’inquiétait que d’autres patient(e)s entrent dans sa chambre, ayant d’ailleurs été attaqué plusieurs fois par d’autres patient(e)s selon le personnel hospitalier. Les membres du personnel ont comparé la situation de Jack pendant la COVID-19 à un « emprisonnement » : aucune possibilité de voir sa famille ou de sortir à l’extérieur hors des limites de la cour. Ils(elles) ont rapporté qu’à cette époque, Jack leur avait dit qu’il « n’avait de place nulle part ». Il aurait supplié sa mère en lui disant « sors-moi d’ici ».
51 C’est uniquement grâce à l’aide d’un(e) membre du personnel hospitalier déterminé(e) et bienveillant(e) que Jack a enfin reçu un diagnostic officiel de déficience intellectuelle. En 2020, il a fait une demande pour bénéficier de services de développement et a été jugé admissible. Avant de pouvoir partir de l’hôpital, Jack a dû attendre encore trois ans et demi pour obtenir un logement et des fonds suffisants parce qu’il devait être surveillé jour et nuit et nécessitait un espace de vie sur mesure pour sa sécurité.
52 Jack n’a pas tout de suite été admis par le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, même s’il avait un diagnostic mixte, avait été hospitalisé pendant des années et était considéré comme un patient nécessitant un autre niveau de soins. C’est seulement lorsque notre Bureau s’est renseigné sur son cas qu’on l’a ajouté à la liste. Selon le personnel ministériel, s’il a été exclu, c’est probablement parce qu’il se trouvait à l’unité des soins cognitifs et non à celle des soins de santé mentale. Puis, lorsqu’un décès est survenu dans un foyer local financé par le MSESC et que Jack a reçu des fonds du projet, il a pu quitter l’hôpital. Malheureusement, il est décédé trois mois seulement après avoir retrouvé la liberté. Il avait 57 ans.
Espoir amenuisé : l’histoire de Luc
53 Luc, 30 ans, est un francophone qui adore les ordinateurs et que les gens qualifient d’« aimable ». Il a un trouble autistique grave, une déficience intellectuelle, un trouble épileptique et un trouble du comportement obsessif-compulsif. Il a aussi un trouble qui le pousse, de façon compulsive et répétée, à arracher ses propres ongles et à se gratter la peau jusqu’à se blesser.
54 Même avec des services de soutien intensif, Luc se sent obligé de détruire les choses autour de lui s’il remarque une imperfection ou un élément qui détonne. Dans un état continu de crise et d’épuisement, sa famille a écrit au MSESC en février 2020 pour demander plus d’aide, expliquant que la situation à la maison était devenue « dangereuse ». Malheureusement, quelques jours après avoir écrit cette lettre, elle a dû appeler le 9-1-1 parce que Luc avait perdu le contrôle, commencé à arracher ses ongles et donné un coup de tête à son père dans la voiture familiale. Luc a été admis à l’unité de psychiatrie d’un hôpital et, hormis un bref séjour dans un foyer en 2024, y demeure depuis bientôt cinq ans.
55 Luc trouve difficile l’environnement bruyant et souvent tendu de l’hôpital. Il est confiné à sa chambre pendant de longues périodes. Quand il devient agité, le personnel hospitalier l’immobilise physiquement ou lui donne des sédatifs parce que le ratio en personnel ne permet pas qu’on lui apporte le soutien nécessaire. Parfois, le personnel parlant français n’est pas disponible, et alors Luc ne se sent pas compris, aux dires de sa famille et d’autres personnes, ce qui contribue à sa frustration et aggrave la situation, d’où le recours à la contention.
56 Des efforts extraordinaires ont été déployés pour donner à Luc un accès aux services de soutien de l’hôpital et pour lui trouver un logement et du soutien appropriés dans la collectivité. Un organisme de services en français a commencé à planifier la transition de Luc hors de l’hôpital, mais a abandonné les démarches quand il s’est aperçu que ses services ne suffiraient pas aux besoins de Luc. Des fonctionnaires ont travaillé avec un(e) gestionnaire de cas pour évaluer toutes les options en français dans la région. Après des recherches infructueuses, l’équipe s’est tournée vers les organismes anglais pouvant offrir des services dans les deux langues, et a même cherché hors de la province. Cependant, les organismes sollicités n’avaient pas le personnel ni les ressources nécessaire, ou encore ils hésitaient à aider une personne n’ayant vécu qu’à la maison ou à l’hôpital lorsque les restrictions de visite liées à la pandémie les ont empêchés de le rencontrer en personne pour évaluer ses compétences et ses comportements actuels. Pendant ses recherches, le personnel du bureau régional a noté ceci : « Il y a un manque flagrant de ressources capables d’offrir un soutien résidentiel intensif dans la région […] aux personnes ayant des besoins comportementaux spéciaux [...]. »
57 Enfin, après plus que quatre ans d’hospitalisation, un organisme a accepté de s’occuper de la transition dans la collectivité, mais le répit de Luc fut de courte durée : après seulement six mois, l’organisme ne pouvait plus gérer ses comportements. Malgré un ratio en personnel de trois pour un, du soutien psychiatrique et les services d’un(e) thérapeute comportementaliste, plusieurs membres du personnel ont subi des blessures. Luc a été admis de nouveau à l’hôpital, et peu après, l’organisme fournissant du soutien comportemental a retiré ses services. Luc était essentiellement retourné à la case départ. Après plusieurs mois, un autre organisme a offert de peut-être dresser un plan de soutien pour permettre la transition de Luc hors de l’hôpital. Ces démarches sont en cours, mais entre-temps, la famille s’inquiète à nouveau du fait que Luc soit immobilisé dans son lit d’hôpital pendant de longues périodes, quittant rarement l’unité de psychiatrie, et perdant espoir.
« Assez inhumain » : l’histoire de Noah
58 À 22 ans, Noah, une personne que l’on dit « pleine de vie », aime écouter de la musique et aller marcher. Il a un trouble sur le spectre de l’autisme, ne peut pas communiquer verbalement, souffre d’anxiété et d’épilepsie et a les fonctions cognitives d’un enfant âgé entre 12 et 18 mois. Élevé à la maison par sa mère, il n’est jamais allé à l’école et a eu peu de contacts avec les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Avec l’âge, son comportement est devenu de plus en plus agressif et difficile à gérer. Sa mère, qui avait constamment peur pour la sécurité de Noah et la sienne, se trouvait à l’amener à l’hôpital ou à appeler les services d’urgence. Après une série de séjours à l’hôpital, Noah a été hospitalisé en août 2021 pendant presque deux ans et demi.
59 Les premiers mois de ce séjour, Noah évoluait relativement « sans contention » selon ses personnes de soutien. Cependant, au huitième mois, son comportement agressif et d’automutilation avait commencé à empirer. Tout le temps qu’il était éveillé, Noah était immobilisé dans son lit, à plat ventre, les membres étendus, attaché à trois ou aux quatre extrémités. Le personnel hospitalier l’immobilisait aussi régulièrement avec des sédatifs. Les proches de Noah nous ont expliqué qu’alors qu’il pouvait auparavant aller à la toilette, se laver et s’habiller avec un peu d’aide, il portait maintenant une couche, avait besoin d’aide pour marcher et perdait ses aptitudes à la vie quotidienne. Quand aucun membre du personnel ne pouvait l’accompagner à la salle de bain ou changer sa couche, il restait couché dans ses draps imbibés d’urine, parfois pendant des heures.
60 Pendant sa dernière année à l’hôpital, ses couches devenaient si saturées que s’y formaient des grumeaux, que Noah a commencé à arracher et à manger. Un(e) professionnel(le) a écrit qu’il passait « tout au plus 60 à 120 minutes par jour sans contention ». La mère de Noah nous a dit qu’il se frappait la tête sur le lit lorsqu’il était attaché et s’est fait mal deux fois jusqu’au sang. Il donnait aussi souvent des coups de pied au mur et s’est blessé si gravement à un orteil qu’il a fallu le lui amputer.
61 Un(e) professionnel(le) s’occupant de Noah qui l’avait observé à l’hôpital a fait la remarque suivante : « On se sent totalement comme si… on assiste presque… à un très haut niveau de négligence auquel on ne peut rien changer… » Un(e) autre a dit qu’il s’agissait « du pire cas sur lequel j’ai travaillé et… cela entraîne des conséquences profondes sur les personnes qui l’aident… J’aimerais savoir s’il y a d’autres personnes qui sont aussi mal traitées au Canada… »
62 Le recours massif à la contention, nous a-t-on signalé, nuisait grandement aux efforts pour assister Noah. Un(e) clinicien(ne) a expliqué qu’il était impossible, dans un milieu hospitalier offrant de telles conditions, d’aider Noah à « se préparer à retourner dans la collectivité ». À l’été 2022, les SOPDI ont classé au niveau maximum les besoins de Noah. Le personnel des SOPDI a dit n’avoir jamais vu cela auparavant. Selon lui, la dégradation s’expliquait probablement par le recours accru à la contention et par l’agressivité croissante, les problèmes d’épilepsie et la perte de mobilité que Noah avait développés pendant son séjour à l’hôpital.
63 Même si Noah approchait le sommet de la liste prioritaire des Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, il s’est avéré difficile de lui trouver un logement et du soutien appropriés dans la collectivité. Son dossier a été examiné par le comité de planification local dans le cadre de son processus d’intervention urgente et ajouté à des registres hors de la région immédiate, mais aucun organisme de services ne s’est proposé au départ. Afin d’inciter les organismes à répondre à l’appel, la gestionnaire du cas de Noah a mis à jour son profil pour mieux rendre compte de sa personnalité et de ses intérêts avant l’hospitalisation. Elle a aussi envoyé un courriel au Ministère, où elle a écrit que « la situation devient assez inhumaine » à l’hôpital et a demandé une rencontre pour discuter d’un plan pour Noah.
64 Enfin, en décembre 2022, après que le personnel régional du MSESC a organisé une réunion avec la gestionnaire de cas, les organismes de services financés par le Ministère et le réseau communautaire de soins spécialisés, un organisme s’est proposé et a commencé à planifier la transition de Noah vers la collectivité. Après des mois de recherche, l’organisme a trouvé une maison unifamiliale qu’il pourrait louer pour Noah – à condition d’obtenir assez de fonds d’immobilisation pour adapter l’espace aux besoins de Noah et de recevoir d’autres fonds pour assurer un ratio en personnel de deux pour un. L’organisme a confirmé que Noah remplissait les critères du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic et, en octobre 2023, le Ministère a approuvé un budget annuel. En mars 2024, Noah emménageait dans sa nouvelle maison. Désormais, Noah profite du soutien du personnel de l’organisme sur place, et les hôpitaux locaux fournissent les soins de psychiatrie et de thérapie comportementale nécessaires. Après deux années passées en grande partie immobilisé dans son lit d’hôpital, Noah porte maintenant ses propres vêtements, n’a plus besoin de couches et peut même jouer au soccer dans sa cour.
Inapte à subir un procès : l’histoire de Sean
65 Sean aime jouer au basketball et aux jeux vidéo et écouter de la musique. Il a 27 ans, mais fonctionne avec les capacités cognitives d’un enfant d’environ 5 ans. Il a un diagnostic d’autisme et de trouble de l’adaptation chronique et vit avec une stomie à cause d’une colostomie qu’il a subie à l’adolescence des suites de la maladie de Crohn.
66 Sean a des comportements agressifs et peut devenir violent. En date de janvier 2019, sa famille devait souvent faire intervenir la police. Un document que nous avons examiné indiquait que la famille avait appelé les services d’urgence 28 fois en huit mois; un autre mentionnait 20 visites de courte durée dans six hôpitaux différents en sept mois. Les spécialistes en psychiatrie consulté(e)s sur le cas de Sean ont recommandé plus de soutiens communautaires et d’interventions comportementales. Soulignant que les milieux hospitaliers aggravaient les comportements de Sean, ils(elles) ont préconisé des solutions externes.
67 À la maison, la famille était toujours en état de crise. Comme la situation était intenable, dans un effort d’obtenir du soutien additionnel pour Sean, des organismes de services l’ont inscrit à une liste d’attente pour une place aux soins comportementaux pour assurer un traitement intensif de courte durée. Ils ont écrit que sans logement sécuritaire avec accès à des soutiens comportementaux, Sean continuerait d’alimenter « une situation extrêmement risquée, insoutenable, dangereuse et préjudiciable ».
68 Malheureusement, aucune place n’a été trouvée, et Sean a attaqué sa mère à la maison en décembre 2019. Cette fois, les policier(ière)s ont suggéré de l’accuser au criminel pour lui obtenir le soutien nécessaire par l’entremise du système judiciaire. À la suite des accusations portées contre Sean, la cour a rendu une ordonnance de non-communication lui interdisant de retourner chez lui, et il a été admis à l’hôpital en application de la Loi sur la santé mentale. La cour a ensuite jugé Sean [Traduction] « inapte à subir un procès » et l’a renvoyé dans un hôpital de soins psychiatriques. La Commission ontarienne d’examen a ordonné qu’il y reste en attendant qu’un logement surveillé jour et nuit soit trouvé dans la collectivité.
69 Toutefois, en l’absence d’un logement et de services pouvant répondre à ses besoins, Sean est demeuré à l’hôpital psychiatrique plus de cinq ans.
70 Pour gérer le comportement agressif et d’automutilation de Sean, l’hôpital a appliqué des mesures de contention mécanique à différents moments, parfois pour des périodes allant de 16 à 20 heures par jour. Selon le personnel des Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle s’occupant de Sean, celui-ci était effrayé par cette transition de la vie en famille à un milieu hospitalier isolé, un sentiment qui, pour cet homme qui réagit mal au changement et aux nouvelles personnes, était exacerbé par le roulement de personnel élevé. Alors qu’il pouvait auparavant participer à l’entretien de sa stomie, ses comportements autodestructeurs et agressifs ont empiré à l’hôpital, et le processus nécessitait maintenant l’intervention de six membres du personnel.
71 Les comportements agressifs et les besoins médicaux complexes de Sean compliquaient les efforts pour lui trouver un foyer, et, parfois, il n'était pas médicalement apte à quitter l'hôpital. Ses besoins s’étant intensifiés à cause de son séjour à l’hôpital, Sean ne pourrait vivre dans la collectivité sans un ration de personnel plus élevé qu’auparavant, à un coût beaucoup plus élevé. Au départ, une place en milieu rural avait été envisagée, mais cette option a été écartée principalement pour les raisons suivantes : il vivrait loin des soutiens médicaux, le transport longue distance pour l’amener aux services de soins serait complexe, et l’organisme ne pourrait pas recruter assez de personnel dans la région.
72 Finalement, lorsqu’un logement s’est libéré en ville, l’organisme de services s’occupant de Sean a pu rénover cet espace, embaucher le personnel requis et obtenir les soutiens nécessaires – infirmiers et psychiatriques – grâce aux fonds accordés par le Ministère. Depuis son déménagement, Sean peut maintenant aller dehors, célébrer les fêtes et vivre de façon plus autonome. Il a fabriqué un panneau pour son entrée où il est écrit : « Ma maison pour toujours ».
Pire que la prison : l’histoire de Kevin
73 Âgé de 27 ans, Kevin adore écouter de la musique. Il est atteint d’autisme, ne peut pratiquement pas communiquer verbalement et réagit avec agressivité quand il est frustré. Sa mère nous a confié qu’elle ne se sentait jamais en sécurité quand il vivait à la maison avec le reste de la famille. Elle s’inquiétait pour le petit frère, qui se cachait dans sa chambre pour se sentir en sécurité. Kevin était inscrit dans un programme de jour, et la famille a pu obtenir certains services grâce au financement de Passeport, mais quand cette aide a pris fin à cause de la pandémie et d’autres problèmes, la situation à la maison a dégénéré.
74 La famille était inscrite auprès des SOPDI pour obtenir un logement avec services de soutien, mais s’est fait dire que l’attente pourrait durer des années, même si Kevin était classé prioritaire dans la collectivité.
75 Les parents de Kevin peinaient à gérer ses comportements à la maison. La police a été appelée à maintes reprises à cause du comportement violent de Kevin, qui était alors admis à l’hôpital puis libéré. Une fois, Kevin a mordu le doigt de son père si fort que celui-ci a dû subir une opération. En novembre 2020, après un autre épisode agressif où la police a été appelée, Kevin a été amené à l’hôpital puis admis à l’unité de psychiatrie.
76 Sa mère a décrit le milieu hospitalier comme étant « pire que la prison ». En raison de son comportement, Kevin était surveillé par des gardes de sécurité, était parfois immobilisé ou isolé et avait rarement l’occasion de sortir de sa petite unité. Le personnel hospitalier savait que l’unité de psychiatrie n’était pas le meilleur environnement pour Kevin. Sa santé physique et mentale déclinait, et il souriait rarement, contrairement à ses habitudes d’avant. Même si l’hôpital voulait « désespérément le libérer » et que les comités de planification locaux le considéraient comme « l’une des [personnes] ayant le plus besoin d’un [hébergement avec services de soutien] en raison de son comportement intense », il s’est écoulé plus de deux ans avant que Kevin puisse quitter l’hôpital.
77 Initialement, aucune place ne convenait pour Kevin, et le Ministère ignorait le montant de financement qui lui serait accordé, voire même s’il y aurait des fonds pour lui.
78 Après un an à l’hôpital, quand Kevin a reçu un diagnostic de trouble de santé mentale, il était l’une des quelques personnes admissibles aux fonds du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic. Toutefois, il dut attendre encore des mois pour qu’une place adéquate se libère. Kevin a finalement pu emménager dans un foyer avec une cour en janvier 2023.
« J’abandonne, tout simplement » : l’histoire d’Anne
79 Anne adore le tricot, la natation et les animaux. Elle a un trouble autistique, un trouble d’anxiété généralisée et un léger retard du développement et souffre d’obésité. Elle a 59 ans, mais n’a eu accès aux services aux personnes ayant une déficience intellectuelle que dans la cinquantaine – et elle a connu plusieurs situations de logement qui n’ont pas fonctionné ou ne répondaient pas à ses besoins.
80 Alors qu’elle vivait dans un foyer avec aide à la vie autonome qui ne fournissait pas le niveau de soutien requis, Anne séjournait à l’hôpital de façon intermittente. Ultimement, ayant désespérément besoin d’un changement et convaincue que quelqu’un viendrait la chercher, elle a quitté son foyer pour l’hôtel. Trois jours plus tard, elle a été trouvée par le personnel hôtelier, seule et incapable de se lever, couchée dans un lit souillé avec rien à boire et seulement des céréales sèches comme nourriture. Une ambulance a été appelée.
81 Anne a de nouveau été admise à l’hôpital à la fin de décembre 2020, et quelques mois plus tard, a été transférée dans un programme spécialisé pour les diagnostics mixtes d’un autre hôpital. Elle est retournée à l’hôpital local en mai 2022, où elle est restée pendant deux ans et demi. Elle nous a dit qu’elle passait la majorité de son temps au lit et qu’elle voulait vivre par elle-même dans la communauté où elle pourrait avoir des ami(e)s. Elle a confié se sentir dans une impasse et a dit à propos de son long séjour à l’hôpital : « J’abandonne, tout simplement, parce que… je ne suis pas heureuse. »
82 Le personnel hospitalier, les SOPDI et un(e) gestionnaire de cas complexes du réseau communautaire de soins spécialisés ont tenté de trouver des options de logement pour Anne, mais celle-ci a été refusée par sept options financées, qui « ne correspondaient pas tout à fait » à ses besoins. D’après le personnel ministériel, les besoins en santé mentale d’Anne ainsi que le manque de financement faisaient obstacle à l’obtention d’un logement approprié. Après plus de deux ans à l’hôpital, Anne n’avait pas droit aux fonds du programme de la planification pluriannuelle des services de soutien ni à ceux du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic – jusqu’à ce que notre Bureau demande des renseignements sur son dossier. Les membres du personnel hospitalier qui essayaient d’aider Anne à trouver un logement ont exprimé leur frustration et leur inquiétude quant à la façon dont Anne était traitée. Ils(elles) ont souligné que ce n’était pas une approche axée sur la patientèle ni une allocation adéquate des ressources, puisqu’elle occupait une place de soins actifs financée par le public.
83 Pendant l’hospitalisation d’Anne, deux options offertes par des organismes de services privés se sont présentées, mais ne se sont pas concrétisées. Même si Anne avait été écartée pour plusieurs options d’hébergement financées par l’État, le Ministère nous a dit que les organismes privés n’étaient envisagés qu’en dernier recours et qu’il n’y avait tout simplement pas de fonds. Anne a aussi été inscrite sur la liste d’attente pour une place en foyer avec services de soutien du MSAN, mais après un an, elle était seulement passée de la 11e à la 8e place.
84 Finalement, Anne a pu emménager dans une maison de retraite privée pour aîné(e)s après qu’un organisme de services qui travaillait sur son dossier a accepté de payer les coûts initiaux à même son budget de fonctionnement, coûts que le Ministère rembourserait à l’exercice financier suivant. Malgré ses difficultés financières, l’organisme a préféré aider Anne à sortir de l’hôpital. Trois jours après la transition, il nous a rapporté qu’Anne se portait remarquablement bien et qu’elle présentait la « meilleure version » d’elle-même. Après quatre mois, le(la) gestionnaire du cas d’Anne a dit que celle-ci continuait d’aller bien, mangeait régulièrement avec les autres résident(e)s dans la salle à manger et avait pu visiter sa fille, avec laquelle elle avait auparavant perdu tout contact.
Demande élevée, offre insuffisante : les obstacles à la transition
85 La principale cause des séjours prolongés à l’hôpital est la pénurie chronique en Ontario de logements adéquats avec services de soutien. Des sept personnes présentées dans ce rapport, aucune n’avait de besoins en soins actifs justifiant un long séjour à l’hôpital, mais aucune n’avait non plus d’endroit dans la collectivité où vivre de façon sécuritaire.
86 Depuis des années dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la demande en logements avec services de soutien excède largement l’offre. De 2020 à 2024, le nombre de personnes inscrites auprès des SOPDI en attente d’une telle place est passé de près de 24 000 à 28 500.
87 Dans une note de breffage interne adressée au ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires en avril 2023, il était indiqué qu’au cours des quatre années précédentes, ce nombre avait crû en moyenne de 9 % par année, tandis qu’il n’y avait eu [Traduction] « essentiellement » aucune augmentation du nombre de personnes servies[16]. En effet, l’examen 2024 des dépenses ministérielles réalisé par le Bureau de la responsabilité financière provincial a révélé une tendance générale caractérisée par une « absence de croissance » dans le nombre de personnes vivant dans un logement avec services de soutien depuis 2017-2018, une stagnation qui a fait s’allonger la liste d’attente. Le Bureau a rapporté que le nombre de personnes sur la liste d’attente avait augmenté de 49 % entre 2017 2018 et 2022-2023[17].
88 Vu les places limitées, les SOPDI utilisent un algorithme pour classer les personnes par ordre de priorité en fonction du niveau de risque posé à la santé ou à la sécurité. Le niveau de risque d’une personne dépend de sa situation de vie et de ses besoins comportementaux, personnels et médicaux, ainsi que de la situation de son aidant(e). Quand une place se libère dans un logement avec services de soutien financé par le MSESC, les SOPDI envisagent d’abord de l’offrir aux personnes dont l’évaluation les classe comme les plus prioritaires.
89 Un(e) coordonnateur(rice) de l’identification et de la liaison examine les dossiers prioritaires pour déterminer à qui la place « conviendrait le mieux » selon des facteurs comme les préférences personnelles, la compatibilité avec les autres résident(e)s et s’il y a assez de personnel pour répondre aux besoins de la personne. Cependant, les SOPDI nous ont expliqué que bien souvent, les places financées disponibles ne conviennent pas aux personnes ayant des besoins complexes. Comme un(e) fonctionnaire des Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle l’a fait remarquer, Luc est « l’exemple parfait d’une personne pour qui on ne peut trouver de place dans nos foyers de groupe parce que ses besoins en soutien sont trop élevés ».
90 Certains logements avec services de soutien financés par le MSAN, qui sont destinés aux personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances graves, peuvent aussi, dans certaines circonstances, accueillir des personnes à diagnostic mixte. La demande pour ces logements excède aussi l’offre, quoiqu’il n’y ait pas de renseignements normalisés sur les délais d’attente. En 2016, la vérificatrice générale de l’Ontario avait recommandé au Ministère de recueillir régulièrement les données sur la liste d’attente et les délais pour chaque région[18]. Malgré cette recommandation, au moment d’écrire ces lignes, le MSAN ne consignait toujours pas les délais d’attente pour les logements avec services de soutien.
91 Malgré l’absence de renseignements consolidés sur les délais à l’échelle provinciale, les faits semblent montrer que l’attente peut être longue. En février 2024, un rapport de l’organisme à but non lucratif Addictions and Mental Health Ontario parlait de listes d’attente s’étirant sur des années pour l’obtention d’un logement avec services de soutien du MSAN. On y mentionne qu’à Toronto par exemple, les personnes ayant des troubles mentaux graves et des besoins complexes qui nécessitent un logement avec services de soutien intensif jour et nuit peuvent attendre jusqu’à cinq ans[19]. Un rapport de suivi publié en mars 2025 par le même organisme relevait que les listes d’attente avaient atteint [Traduction] « un niveau de crise ». On estimait que le temps d’attente moyen pour obtenir une place avec services de soutien en santé mentale en Ontario frôlait les quatre ans; à Toronto, il excédait huit ans[20]. On constatait aussi des besoins croissants en logements avec soutien intensif; un organisme de coordination de Toronto rapportait que 40 % des personnes ayant essuyé un refus avaient des besoins auxquels les services disponibles ne pouvaient répondre. Enfin, bon nombre des personnes sur la liste d’attente se trouveraient dans un refuge, à l’hôpital ou dans un logement ne répondant pas à leurs besoins.
Refusé(e)s et délaissé(e)s
92 Quand les SOPDI sont incapables de trouver une option convenable à une personne ayant des besoins urgents parmi les places disponibles financées par le MSESC, le dossier est transféré à un comité de planification de la région, et parfois d’autres régions, pour que les organismes locaux financés par l’État tentent de trouver une solution. Un(e) haut(e) responsable d’un organisme aidant les familles à obtenir des services nous a dit que ce transfert relève habituellement plus de la « formalité » que d’une solution pour des gens comme Luc ou Noah, vu la grande rareté des organismes pouvant ou voulant aider les personnes aux besoins complexes et élevés. Le(la) coordinateur(trice) pour les personnes à diagnostic mixte d’un hôpital dans une autre région a affirmé que jamais aucun(e) de leurs patient(e)s de longue durée ayant une déficience intellectuelle n’avait quitté l’hôpital pour un logement existant avec services de soutien financé par l’État.
93 Ainsi, les personnes ayant les besoins les plus importants doivent parfois se tourner vers des organismes privés. Cependant, ces derniers peinent aussi à fournir le personnel et les ressources nécessaires. Dans le cas de Luc, un organisme privé avait envisagé de l’aider, mais n’avait pas assez de personnel pour le faire. Un autre n’avait pas de personnel bilingue pouvant le servir en français.
94 Même quand un organisme privé est prêt à offrir une place avec services de soutien, cette solution peut tomber à l’eau à cause du manque de fonds. Dans le cas d’Anne, alors que l’hôpital avait trouvé un organisme privé disposé à répondre à ses besoins, l’absence de financement par le MSESC l’a contrainte à rester à l’hôpital. Le personnel ministériel de la région nous a dit n’accorder des fonds aux organismes privés qu’en dernier recours, cherchant plutôt à accroître la capacité du système public. Or, lorsque le plan de l’organisme privé a échoué, le dossier d’Anne avait déjà été présenté à différents comités de planification dans la région à maintes reprises – et refusé pour au moins sept places. De même, le dossier de Jack avait été soumis à des comités de planification communautaires pendant des années, en vain.
95 Il ne s’agit pas de cas isolés. Le personnel hospitalier avec qui nous avons parlé et les documents ministériels que nous avons examinés[21] confirment que des personnes ayant une déficience intellectuelle sont restées à l’hôpital pendant 10 ans ou plus parce qu’il n’y avait dans la collectivité aucun organisme de services en mesure de les aider.
Institutionnalisation à l’hôpital
96 Plus une personne ayant une déficience intellectuelle reste longtemps à l’hôpital, plus sa transition dans la collectivité risque d’être difficile. En effet, comme nous l’a expliqué le personnel hospitalier, plus l’hospitalisation perdure, plus la personne risque de devenir dépendante d’un ratio en personnel élevé et d’une aide dans ses activités quotidiennes. Au fil du temps, elle s’habitue à la vie à l’hôpital et devient moins capable de s’adapter à une nouvelle routine ou à en créer une. Comme un(e) fonctionnaire du MSESC l’a résumé : « L’expérience montre que l’environnement de soutien conditionne la capacité d’une personne à s’adapter à la vie dans la collectivité. »
97 Le personnel d’un hôpital nous a parlé d’un homme dans la trentaine ayant une déficience intellectuelle et un trouble important de santé mentale qui avait été hospitalisé pendant près de 14 ans. L’hôpital a déterminé, peu après son admission en 2009, qu’il n’avait pas besoin de soins hospitaliers. Les comités de planification communautaire ont examiné le dossier mensuellement pendant près de huit ans jusqu’à ce qu’un organisme accepte enfin de s’occuper de sa transition dans la collectivité. Malheureusement, l’homme est retourné à l’hôpital peu après parce que l’organisme n’arrivait pas à gérer ses comportements. Selon le personnel hospitalier, il était devenu « institutionnalisé » et voyait désormais l’hôpital comme son chez-soi.
98 Quand une personne devient institutionnalisée et perd son autonomie et ses aptitudes à la vie quotidienne, elle devient parfois plus dépendante des ressources de soutien, ce qui complique pour les organismes la planification et la prestation des services dans la collectivité. Un(e) consultant(e) comportemental(e) qui travaille dans le secteur depuis plus de 20 ans nous a dit que les personnes coincées à l’hôpital ont un « profil au dossier qui peut sembler assez… exigeant », d’où la réticence des organismes à proposer leurs services. Par exemple, contrairement aux hôpitaux, les organismes qui servent les personnes ayant une déficience intellectuelle n’ont généralement pas l’infrastructure ou le personnel spécialisé nécessaires pour intervenir quand la personne devient extrêmement agressive.
99 Un(e) fonctionnaire du MSESC a expliqué que souvent, les personnes ayant des besoins très complexes sont « ignorées » par les organismes de services. Cela crée un cercle vicieux qui fait perdurer leur séjour à l’hôpital.
100 Bien des cas figurant dans le présent rapport témoignent des graves conséquences d’une longue hospitalisation. Après des années d’hospitalisation, Jack a perdu son autonomie et avait de plus en plus besoin d’aide dans des tâches quotidiennes simples. Noah n’avait plus les aptitudes de base nécessaires pour aller à la salle de bain et avait été immobilisé dans un lit d’hôpital si longtemps que personne ne pouvait prédire comme il réagirait si on l’emmenait ailleurs. Un(e) coordinateur(trice) de services a fait observer que « très, très peu d’organismes accepteraient une personne qui a été immobilisée aux quatre extrémités à l’hôpital ». Pour Noah, même quand un organisme, touché par son histoire, lui a enfin offert un chez-soi, la transition n’a été possible que grâce à des fonds additionnels pour des rénovations et à l’ajout de personnel en soins psychiatriques et comportementaux. Et encore, il a fallu 15 mois supplémentaires pour mettre tout en place pour la transition de Noah.
101 Ce sont ultimement les organismes de services qui déterminent s’ils ont la capacité de soutenir la personne. Le personnel du MSESC a dit savoir que certains organismes ne veulent pas assumer le risque que la personne, si elle a des besoins comportementaux élevés, blesse des membres du personnel, ajoutant que lorsqu’un organisme accueille quelqu’un alors qu’il est incapable de fournir le soutien nécessaire, il risque de faire plus de mal que de bien. La situation d’Anne en est un bon exemple : elle s’est retrouvée dans une chambre d’hôtel, incapable de s’occuper d’elle-même, après avoir emménagé dans un logement financé par le Ministère qui ne répondait pas à ses besoins. Néanmoins, le personnel ministériel a aussi souligné que cela fait partie de son rôle de surveillance de s’assurer que les organismes ne s’arrêtent pas là où commence le risque, car la prestation de services aux « citoyen(ne)s vulnérables » est « leur raison d’être ».
Un système « plafonné »
102 Même quand un organisme de services est disposé à servir une personne ayant des besoins très complexes, bien souvent, il n’y a simplement aucun endroit adéquat qui soit prêt ou qui puisse être adapté. Un(e) fonctionnaire du MSESC nous a expliqué qu’entre 1977 et 2009, lorsque les établissements du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle fermaient, des mesures ont été prises pour que l’on puisse s’occuper des personnes ayant des besoins importants. Le secteur a aussi créé des « ressources non financées », dont un registre des pièces, des chambres et des autres unités de logement libres pouvant servir à une expansion éventuelle. Malheureusement, cette pratique a été abandonnée, et aujourd’hui, les places disponibles ont « plafonné ». Elles sont soit toutes occupées, soit inhabitables en raison de l’évolution des exigences comme la réglementation, les règlements municipaux et les codes de sécurité incendie. Un(e) fonctionnaire a dit s’inquiéter de ce que les logements pour ces personnes ont atteint un « point critique », les organismes de services signalant qu’il ne reste plus d’espaces pouvant être convertis.
103 Le rétrécissement du parc de logements pour les personnes ayant une déficience intellectuelle avait été prédit dans une note de programme ministérielle en octobre 2018[22]. On y indiquait qu’il avait été demandé aux organismes de services d’attribuer dans leur planification pluriannuelle les ressources en logement disponibles aux personnes ayant les plus grands besoins, mais que [Traduction] « la capacité du système sera réduite sans ajout de fonds afin de répondre à la hausse des coûts et de la demande en services ».
104 Un(e) fonctionnaire nous a dit que désormais, « il faut pratiquement que quelqu’un décède pour qu’une place se libère ». Les parents et les fournisseurs de services avec qui nous avons parlé abondaient dans le même sens. Jordan et Jack n’ont pu quitter l’hôpital que grâce au décès d’un(e) résident(e) dans un logement financé par le Ministère. Des statistiques du MSESC émises en 2019 montraient que chaque année, 1 500 nouvelles personnes demandaient une place avec services de soutien financée, mais qu’environ 450 places seulement se libéraient[23].
105 Le MSAN ne fait pas le suivi de la demande pour ses programmes de logement avec services de soutien, dont certains, d’après ce qu’on nous a rapporté, pourraient servir les personnes à diagnostic mixte. Cependant, dans un rapport de février 2024 sur les logements avec services de soutien pour les troubles de santé mentale et la dépendance, on indiquait que les fournisseurs de ces logements doutaient que le système ait les capacités d’admettre un volume croissant de personnes ayant des besoins en santé mentale complexes[24].
Une tendance troublante
106 Si la pénurie de logements adéquats est un problème de longue date dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, des signes montrent que la situation empire. Une note de breffage du MSESC émise en avril 2023 rapportait une hausse de 8 % du nombre de personnes ayant des besoins complexes et élevés par rapport à l’année précédente[25]. Elle signalait en outre que le nombre de personnes autistes recevant des fonds du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées avait augmenté de 5 % entre 2017 et 2022, et que 20 % des personnes autistes âgées de 18 à 24 ans avaient des besoins comportementaux [Traduction] « exceptionnels ». Dans un autre document ministériel émis à l’interne en septembre 2021 concernant le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, on estimait que 20 % des personnes ayant un diagnostic mixte et résidant dans un hôpital psychiatrique ontarien étaient considérées comme des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins, et que près de la moitié attendaient un logement dans la collectivité avec services de soutien intensifs[26].
107 Un(e) responsable du Ministère a candidement admis qu’en raison du degré de complexité et de la concomitance des troubles, « nos solutions ne répondent plus aux besoins des personnes qui arrivent dans le système aujourd’hui ».
108 Par ailleurs, les parents s’occupant à la maison de leurs enfants adultes ayant une déficience intellectuelle vieillissent. La note de breffage du MSESC d’avril 2023 indiquait que 11 200 personnes ayant une déficience intellectuelle vivent avec un(e) aidant(e) de 60 ans ou plus, et que ce nombre devrait atteindre environ 17 400 au cours des cinq prochaines années[27].
109 Il est troublant de constater que la complexification des besoins et le vieillissement des aidant(e)s arrivent à un moment où les ressources communautaires sont si rares pour les personnes les plus difficiles à aider. Plus les besoins d’une personne sont élevés, moins il y a de ressources. Si ces tendances se maintiennent, les personnes hautement vulnérables ayant une déficience intellectuelle continueront inévitablement de dépérir dans les hôpitaux et d’autres milieux inadéquats. Comme nous l’avons vu dans les cas présentés ici, bien des personnes laissées à l’hôpital régresseront mentalement et physiquement et perdront d’importantes aptitudes à la vie quotidienne, ce qui rendra leur transition dans la collectivité plus difficile et souvent plus dispendieuse. Au surplus, elles continueront d’occuper une place qui pourrait autrement servir à des personnes ayant besoin de soins médicaux actifs. Les familles, le personnel hospitalier et les professionnel(le)s des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle continueront de chercher des solutions qui n’existent pas, et la population devra payer les frais d’un système fournissant les mauvais soins au mauvais endroit.
Toujours dans l’impasse : lacunes systémiques
110 Il y a neuf ans, dans mon rapport de 2016 intitulé Dans l’impasse, j’avais traité de la pénurie extrêmement troublante de logements adéquats pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et affichant un comportement agressif ou violent[28]. J’avais aussi encouragé le Ministère à réaliser des recherches et des consultations dans les secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L’objectif était de mettre en place des ressources d’hébergement avec services de soutien adaptées aux besoins exceptionnels de ces personnes. J’avais recommandé au Ministère de créer un répertoire des options adéquates de logement parce que le système laissait beaucoup de gens indûment hébergés dans des hôpitaux, des refuges, des foyers de soins de longue durée et même des prisons[29]. Le Ministère a bel et bien mené des recherches sur la situation des logements avec services de soutien pour les personnes ayant des besoins médicaux ou comportementaux exceptionnels, mais il lui reste toujours à dresser un répertoire des logements pouvant répondre à ces besoins.
111 Depuis 2016, les personnes indûment hospitalisées se heurtent à la pénurie de logements affectant le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Comme l’a rapporté le Bureau de la responsabilité financière en 2024, on remarque une tendance caractérisée par une [Traduction] « absence de croissance » dans le nombre de personnes servies depuis 2017-2018[30]. Le système reste réactif et fragmenté.
Recherche après recherche
112 La pénurie de logements adaptés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes ou concomitants ne date pas d’hier. Pendant plus d’une décennie, des chercheur(euse)s ont signalé le problème, proposé des solutions et lancé des appels à l’action.
113 En 2009, le Centre de toxicomanie et de santé mentale a publié From hospital to Home: The Transitioning of Alternate Level of Care and Long-stay Mental Health Clients[31]. Commandé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’époque, ce rapport révélait que la pénurie de logements avec services de soutien intensif, combinée aux [Traduction] « problèmes de coordination » entre les systèmes de santé et de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, contribuait à l’hospitalisation de personnes à diagnostic mixte en tant que patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins. Le Centre recommandait que les ministères responsables de ces deux systèmes travaillent avec les responsables de l’administration régionale des services de soins de santé publics afin de créer des logements avec services de soutien adaptés aux personnes à diagnostic mixte. Il préconisait aussi une communication et une collaboration accrues entre la collectivité et l’hôpital afin d’assurer la mise en place des soutiens adéquats avant la sortie de ces personnes.
114 En 2012, KPMG a publié un rapport[32], commandé par six hôpitaux psychiatriques de l’Ontario, qui évaluait les lacunes dans les programmes hospitaliers et le système accueillant les personnes à diagnostic mixte. On y constatait que dans les six hôpitaux, ces personnes représentaient 37 % des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins. Les participant(e)s à l’examen comptaient des médecins de ces programmes et des représentant(e)s des centres de toxicomanie et de santé mentale. Tou(te)s étaient d’avis que l’accès limité aux logements avec services de soutien dotés de personnel suffisant et compétent contribuait au nombre élevé de patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins qui ont un diagnostic mixte. Le rapport concluait qu’il fallait élargir l’éventail de logements, [Traduction] « surtout pour les personnes aux besoins complexes nécessitant un soutien plus intensif ».
115 En 2014, le MSESC a mis sur pied le Groupe de travail sur le logement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, le chargeant de rechercher des solutions innovatrices à la « grave pénurie de logements » dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En 2018, ce groupe de travail a adressé des recommandations au Ministère pour qu’il étudie les enjeux et trouve des solutions interministérielles afin d’améliorer la situation des personnes ayant une déficience intellectuelle, y compris celles ayant de multiples besoins ou connaissant des conditions de vie complexes ou précaires, soulignant qu’actuellement, des milliers de personnes n’avaient pas le soutien au logement nécessaire[33].
116 En février 2019, le programme Health Care Access Research and Developmental Disabilities du Centre de toxicomanie et de santé mentale, l’Institute for Clinical Evaluative Sciences et l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario ont publié un rapport intitulé Addressing Gaps in the Health Care Services Used by Adults with Developmental Disabilities[34]. On y constatait que les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle étaient 6,5 fois plus susceptibles d’être considéré(e)s comme nécessitant un autre niveau de soins, ce qui témoignait de problèmes dans la disponibilité ou l’accessibilité de soutiens communautaires adéquats. Le rapport concluait aussi que les visites aux urgences et les hospitalisations étaient plus probables et plus fréquentes chez les personnes ayant à la fois une déficience intellectuelle et un diagnostic de trouble de santé mentale.
117 En 2022, le Centre de toxicomanie et de santé mentale a conçu le Housing and Mental Health Policy Framework[35], qui soulignait les difficultés d’accès au logement propres aux patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins qui ont des troubles de santé mentale graves et des besoins complexes. Ce cadre recommandait notamment que le MSESC et le MSAN collaborent pour créer des projets de logement destinés aux personnes à diagnostic mixte.
118 En 2023, le Centre de toxicomanie et de santé mentale a publié un rapport, commandé par le MSAN dans le cadre du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, intitulé Supporting Alternate Level of Care Patients with a Dual Diagnosis to Transition from Hospital to Home: Practice Guidance[36]. Faisant écho à des constatations et recommandations précédentes, ce document invitait les secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle (y compris les deux ministères et Santé Ontario) à travailler ensemble pour mettre en place un ensemble minimal de services de base doté de ressources adéquates pour les personnes à diagnostic mixte. Il suggérait d’offrir ces services à l’échelle de la province ainsi que différentes options de logements et de soutiens communautaires dotés de personnel adéquatement formé. De plus, il faisait valoir que les décisions sur les modèles de logement devaient être éclairées par les données sur les besoins de la population.
Progrès freinés
119 Malgré ces appels à l’action et ces recommandations de réforme légitimes et répétés, des progrès négligeables ont été réalisés dans l’offre de logements avec services de soutien adéquats dans la collectivité pour des gens comme Jordan, Sean, Jack, Luc, Noah, Anne et Kevin.
120 Dans tous les cas de figure présentés ici, les démarches pour trouver un organisme de services privé ou financé par le Ministère qui soit capable de fournir un soutien répondant à des besoins multiples ou complexes ont été ardues et ont souvent duré des années. C’était ainsi même quand la personne était considérée comme hautement prioritaire pour l’obtention de services dans la collectivité.
121 De nombreux fonctionnaires des secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle nous ont exprimé leur frustration face au manque de ressources en logement adaptées à ces personnes. Pour certains(e)s, l’absence de logements adéquats est le plus grand obstacle rencontré par les personnes cherchant à quitter l’hôpital. Un(e) membre du personnel d’un hôpital a affirmé qu’il était « virtuellement impossible » pour une personne ayant une déficience intellectuelle, et surtout un diagnostic mixte, de trouver un logement adéquat dans la collectivité.
122 Dans mon rapport Dans l’impasse, j’ai décrit les hôpitaux comme une solution de fortune pour remédier au manque de logements dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. J’ai écrit que « [d]e nos jours, le système de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle n’est pas le reflet d’une planification stratégique à long terme de la part du Ministère, mais ressemble plutôt à un magma de visions diverses et individualisées de centaines d’organismes non gouvernementaux actifs dans ce secteur[37]. »
123 Après la publication de ce rapport, j’ai vu un certain progrès dans la planification du système vers l’offre de logements destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et de logements avec services de soutien en général. En 2017, le ministère des Services sociaux et communautaires de l’époque et le ministère de la Santé ont collaboré avec d’autres ministères pour créer le Cadre stratégique du logement avec services de soutien de l’Ontario, une initiative intersectorielle[38]. Ce cadre établissait l’importance d’offrir des logements avec services de soutien aux personnes ayant des besoins complexes pour les aider « à se loger de façon permanente, à s’épanouir et à vivre de la façon la plus autonome possible au sein de leur collectivité ». Parmi les objectifs, mettre en place un système plus coordonné où les ministères, les entités locales comme les gestionnaires de services, les réseaux locaux d’intégration des services de santé (qui font maintenant partie de Santé Ontario), les fournisseurs de logement et les autres acteurs travailleraient de concert dans une approche davantage axée sur la personne afin de répondre aux besoins en matière de logement.
124 Le MSESC a pris des mesures pour appliquer les recommandations du rapport Dans l’impasse, notamment chercher des façons de prioriser les personnes ayant des besoins complexes et investir dans le renforcement des capacités du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En date d’avril 2018, il avait élaboré une stratégie sur le logement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle[39] visant à améliorer l’accès à différents services de soutien et de logements abordables et axés sur la personne pour répondre aux besoins de chacun(e).
125 La même année, le Ministère a aussi proposé une initiative visant à multiplier les options de logement avec services de soutien destinées aux personnes prioritaires qui sont indûment hébergées dans des endroits comme des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée et des établissements correctionnels. Le budget projeté s’élevait à 31 millions de dollars. Dans le cadre de cette initiative, des ressources auraient été réservées aux personnes hébergées dans des milieux inadéquats par l’entremise du programme de la planification pluriannuelle des services de soutien.
126 Toutefois, après un changement de gouvernement et une directive pangouvernementale de coupure des dépenses, le sous-ministre adjoint de la Division des services ministériels et de la planification des activités a soumis une note de service au Comité de gestion du MSESC pour demander à tous les secteurs de programmes de revoir leurs prévisions budgétaires. Entre autres, il fallait ralentir et diminuer les dépenses et réviser les stratégies des programmes pour réaliser des économies, notamment en retardant la mise en œuvre[40].
127 En réponse, le personnel du MSESC a préparé une note d’information pour la ministre pour faire approuver sa stratégie de gestion des dépenses[41]. Le financement auquel le Ministère renonçait comprenait 25 millions de dollars pour les services de soutien au logement et 6 millions en immobilisations pour les personnes indûment hébergées. Seraient également retirées des propositions comme les logements innovateurs, « living at home longer » et les nouveaux lieux de vie et espaces de répit avec services de soutien.
128 À la même époque, toujours en 2018, alors que le Ministère abandonnait son projet de bonifier le financement afin d’améliorer les ressources en logement dans le secteur, le Groupe de travail sur le logement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qu’il avait mis sur pied en 2014 réclamait une solution à [Traduction] « l’approche motivée par la crise pour répondre aux besoins en logement ». Dans son rapport Generating Ideas and Enabling Action: Addressing the Housing Crisis Confronting Ontario Adults with Developmental Disabilities[42], il soulignait qu’alors que les listes d’attente pour un logement continuaient de s’allonger, la planification du système devait passer en mode « prévention ». Le rapport évaluait et analysait 18 projets de logement collaboratifs et innovateurs, dont certains visaient les personnes ayant des besoins complexes.
129 D’après ses documents, le MSESC comptait évaluer ces modèles pour recenser les pratiques exemplaires pouvant être reproduites grâce à de nouveaux investissements dans les logements innovateurs et pour tirer pleinement parti d’autres partenariats communautaires afin de diversifier les logements offerts. Pourtant, en juillet 2019, un document interne concernant le Cadre de réforme des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle indiquait que le MSESC ne s’était toujours pas doté d’une stratégie générale pour réformer [Traduction] « de manière efficace et efficiente » les services de logement avec soutien, stratégie qui, selon ce même document, devait inclure pour les services de logement destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle une vision officielle appuyée par les parties prenantes[43].
De retour en veilleuse
130 L’élan suscité par mon rapport Dans l’impasse a faibli et ralenti. Les efforts pour résoudre le problème se sont poursuivis, mais les progrès restent lents et minimes.
131 En 2020, une évaluation des services de développement par KPMG, préparé pour le MSESC, relevait que l’Ontario n’atteignait pas les cibles en [Traduction] « refonte de marché ». Malgré les projets innovateurs entrepris par des organismes hautement efficaces, il n’existe pas, selon ce rapport, de mécanisme permettant de les appliquer à l’échelle provinciale[44].
132 La même année, le Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est a établi un groupe de travail se consacrant à la recherche de solutions plus proactives pour les personnes à diagnostic mixte qui sont forcées de rester à l’hôpital. Ce groupe de travail, auquel siégeaient des représentant(e)s du MSESC, a examiné le dossier des personnes hospitalisées parce qu’exclues de l’actuel système de services destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Il devait trouver des solutions pour assurer la prestation de services adéquats aux personnes ayant un diagnostic mixte et des besoins élevés.
133 Le groupe de travail a analysé les données et les dossiers de la patientèle sur plusieurs années. En 2021, il a rapporté que les personnes hospitalisées ayant des besoins insatisfaits en matière de logement avaient souvent :
- un retard du développement et des diagnostics multiples et distincts de troubles de santé mentale;
- un diagnostic de troubles les plus graves sur le spectre de l’autisme (habituellement, aucune communication verbale ou aptitudes très limitées);
- besoin d’aide dans la majorité des aspects de la vie quotidienne;
- fait l’objet d’une évaluation comportementale aux conclusions sévères;
- des antécédents d’agressivité ou de démêlés avec la justice pénale.
134 Les auteur(e)s ont noté que le nombre de personnes correspondant à ce profil était [Traduction] « relativement petit ». Ils(elles) ont aussi constaté que plus le séjour à l’hôpital perdurait, plus il était difficile de trouver un logement adéquat. La liste des soutiens essentiels nécessaires dans la collectivité pour les patient(e)s de longue durée ayant des besoins complexes comprenait la formation d’équipes de soutien clinique spécialisées et multiorganisationnelles, la multiplication des logements spécialisés, l’affectation de fonds à la rénovation de logements, la création de partenariats multisectoriels entre les fournisseurs de logements avec services de soutien du secteur des personnes ayant un handicap et du secteur des personnes ayant des troubles de santé mentale pour assurer l’intégration, et la planification des systèmes pour le logement.
135 Les fonctionnaires de Santé Ontario connaissant le projet nous ont dit que le travail réalisé était « fantastique », mais que les progrès avaient été freinés en raison de ressources insuffisantes, de problèmes de dotation en personnel et des priorités changeantes.
136 Dans un document interne de 2022[45], des fonctionnaires du MSESC faisaient observer que les logements avec services de soutien pouvaient réduire le recours aux services plus coûteux financés par le gouvernement, [Traduction] « comme les visites aux urgences, les séjours à l’hôpital, les interventions policières, les démêlés avec la justice (dont les séjours en prison) et les soins de longue durée ». Un autre document interne de la même époque, faisant état de l’insuffisance des ressources en logement, formulait plusieurs suggestions de réforme. L’une consistait à créer des partenariats pour multiplier les logements avec services de soutien abordables, selon l’argument suivant : [Traduction] « On ne peut pas y arriver en vase clos[46]. »
137 Malgré ces multiples examens approfondis, aucun plan détaillé n’a encore été créé pour soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes qui ne réussissent pas à trouver de logement adéquat. Bien des haut(e)s fonctionnaires du MSESC avec qui nous avons parlé ont dit n’être au courant d’aucune stratégie de logement pour le soutien à la vie autonome pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.
138 Des démarches ont été entreprises pour concevoir une « Initiative multiministérielle pour le logement avec services de soutien », un projet collaboratif chapeauté par le ministère des Affaires municipales et du Logement. Mais d’après le MSESC et le MSAN, cette initiative serait dans ses « premières phases ». Elle vise à offrir des logements avec services de soutien aux « populations vulnérables » en général, mais il demeure incertain si elle permettra de combler les lacunes en logement pour les personnes ayant les besoins les plus complexes, et si oui, comment cette initiative le fera.
139 Le MSAN dirige aussi l’élaboration de politiques entourant l’offre de logements locaux avec services de soutien intégrés dans le cadre de l’Initiative. Le personnel nous a expliqué qu'une politique, en cours de rédaction, obligerait les partenaires du secteur de la santé à décloisonner leurs pratiques et à collaborer avec les gestionnaires des services municipaux et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour planifier les logements avec services de soutien. Cette politique ressemble aux exigences de collaboration multisectorielle prévues dans le Cadre stratégique du logement avec services de soutien de 2017. Cependant, au début de 2025, des fonctionnaires du ministère de la Santé nous ont dit que ces démarches avaient été mises « en veilleuse », parce que l’accent était désormais mis sur le déploiement des carrefours d’aide aux sans-abri et de lutte contre les dépendances en remplacement des sites de consommation sécuritaire de drogues. À leurs dires, ces carrefours offriraient des logements avec services de soutien, dont certains pourraient accueillir des personnes à diagnostic mixte. Néanmoins, les fonctionnaires ont indiqué que ces logements ne conviendraient probablement pas aux patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins et ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes, comme les personnes décrites dans le présent rapport. Ils ne seraient probablement pas d’une grande aide non plus pour les personnes ayant une déficience intellectuelle mais pas de trouble de santé mentale ni de dépendance.
140 Même s’il n’y a guère eu de progrès à l’échelle provinciale dans l’adoption d’une stratégie de renforcement des capacités en matière de logement dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, nous avons entendu parler de plusieurs initiatives locales visant à multiplier les options de services de soutien intensif. Par exemple, un organisme de services torontois a fait équipe avec un hôpital local pour accroître les ressources en logement avec services externes hospitaliers offertes aux personnes ayant des besoins complexes, y compris celles ayant un diagnostic mixte. Le financement du projet de soins alternatifs pour les personnes présentant un double diagnostic et d'autres financements ministériels ont permis à plusieurs personnes de quitter l'hôpital pour emménager dans ce logement. Dans la région de l’Est, il y a un comité d’organismes de services qui cherche à trouver des possibilités de collaboration pour offrir des logements et des soutiens aux personnes ayant des besoins élevés. Ces initiatives sont prometteuses, mais elles ne constituent pas l’approche coordonnée et exhaustive nécessaire pour résoudre le problème dans la province en entier.
Une approche de renforcement des capacités réactive et insuffisante
141 En l’absence de plan proactif de renforcement des capacités pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, le MSESC et le MSAN continuent d’appliquer des mesures réactives, enclenchées par les crises, qui ne répondent pas aux besoins systémiques globaux ni à la demande croissante en services.
142 Le MSESC compte principalement sur le processus annuel de la planification pluriannuelle des services de soutien (PPSS) pour attribuer de nouveaux fonds au renforcement des capacités et à la transition des personnes prioritaires vers les services et les soutiens financés. En général, ce processus ne permet d’aider qu’une personne à la fois sur la liste d’attente pour une place dans la collectivité.
143 Les fonds sont accordés en priorité aux jeunes pris(es) en charge par le système de bien-être de l’enfance (les pupilles de la Couronne) et aux enfants recevant des fonds pour des besoins particuliers complexes qui deviennent admissibles aux services aux adultes ayant une déficience intellectuelle. Ce soutien est accordé chaque année aux personnes appartenant à l’un de ces deux groupes qui sont considérées comme étant à risque élevé d’itinérance, afin de faciliter leur transition harmonieuse vers les services aux adultes. Les autres personnes pouvant avoir droit à ce financement sont inscrites sur ce qu’on appelle la « liste d’attente pour une place dans la communauté ». Il peut s’agir de personnes indûment hébergées dans des hôpitaux, des maisons de transition ou des refuges, ou de personnes en situation d’itinérance ou à « risque élevé » d’itinérance. Les personnes prioritaires sur cette liste d’attente se voient accorder le montant restant une fois les fonds attribués aux jeunes en âge de changer de système.
144 Comme nous l’avons vu dans les cas de Luc et de Kevin, les fonds prévus dans la planification pluriannuelle des services de soutien sont souvent indisponibles parce que les montants sont reportés dans l’exercice financier, ou encore, les fonds disponibles ne suffisent pas pour les personnes inscrites sur la liste d’attente, surtout lorsque celles-ci ont des besoins élevés. Un(e) fonctionnaire nous a dit que les coûts des services de soutien et de logement pour Luc auraient « absorbé » à eux seuls tous les fonds alloués à la région. Dans un document interne du MSESC préparé la veille de l’admission de Kevin à l’hôpital, les fonctionnaires signalaient qu’étant donné le nombre d’adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins pressants dans la région, les fonds de la planification pluriannuelle des services de soutien ne suffiraient pas à couvrir les coûts à prévoir pour les personnes [Traduction] « indûment hébergées à l’hôpital ou sur le point de perdre leurs services dans la collectivité[47]. »
145 La planification souffre également de la variabilité du calendrier annuel d’allocation des fonds. Parfois, l’exercice financier est commencé depuis des mois quand les bureaux ministériels régionaux et les comités de planification apprennent enfin le nombre de personnes sur la liste d’attente qui pourront être servies. Et lorsque le montant est dévoilé, il couvre rarement les coûts des services de soutien et de logement des personnes ayant des besoins urgents. Par conséquent, les fournisseurs de services et le personnel régional du MSESC doivent se démener pour assembler des fonds pour offrir un soutien, même temporaire.
146 Depuis 2020, l’écart se creuse toujours davantage entre les cibles fixées par le Ministère et le nombre de personnes sur la liste d’attente profitant du soutien issu du processus de planification annuelle. Même les cibles du MSESC ne reflètent qu’une petite partie des personnes qui, vu leur situation urgente, ont besoin de fonds pour obtenir un placement et un soutien adéquat. Pour 2020 2021, le Ministère avait initialement déterminé que 250 personnes hébergées inadéquatement recevraient des fonds, mais en cours d’année, la cible a été ramenée à 70 pour toute la liste d’attente, et en fin de compte, des fonds ont été versés pour 84 personnes. En 2021-2022, il a augmenté sa cible de 120 à 150 en réponse à la demande urgente, et servi 169 personnes. Malheureusement, cette augmentation ponctuelle est loin d’avoir suffi pour renverser la tendance.
147 Les deux années suivantes, le financement restant pour les personnes prioritaires de la liste n’a pas suffi pour atteindre les cibles. En 2022-2023, le financement devait couvrir 120 personnes, mais seulement 20 ont pu en profiter. L’année suivante, avec la même cible, seules 60 personnes ont été servies. La situation était encore pire en 2024-2025 : le MSESC avait encore prévu de loger 120 nouvelles personnes, mais il n’est resté de fonds pour personne sur la liste, l’entièreté du financement ayant servi aux jeunes prioritaires en âge de changer de système.
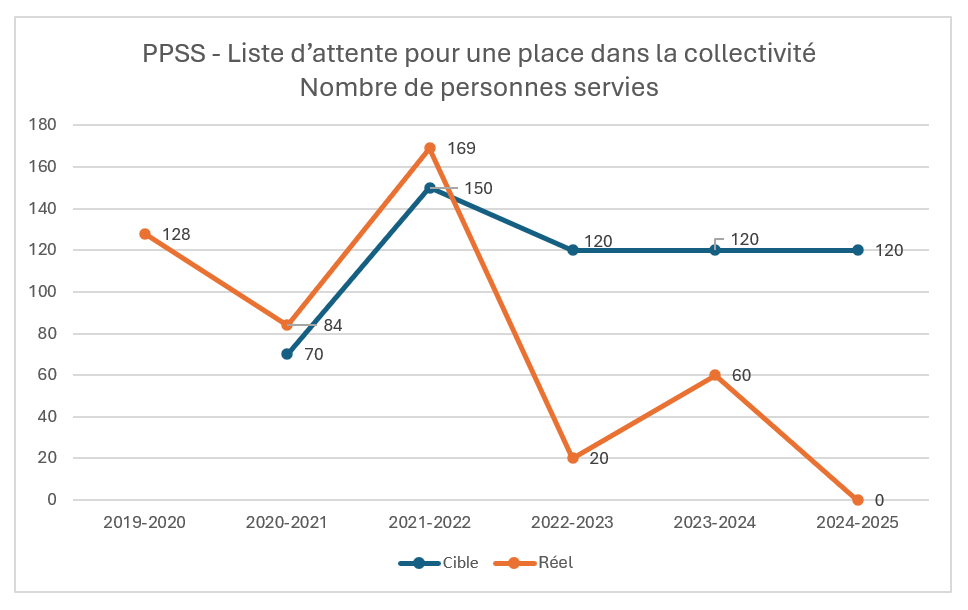
148 Le personnel ministériel a expliqué la diminution des fonds pour les adultes prioritaires sur la liste d’attente pour une place dans la collectivité par la hausse du nombre de jeunes prioritaires en âge de passer au système pour adultes et ayant des besoins de plus en plus complexes. D’après le personnel responsable du programme de la planification pluriannuelle des services de soutien, l’inflation et la complexification des besoins se traduisent par une augmentation annuelle du coût moyen des logements avec services de soutien.
149 Les dossiers du Ministère montrent que celui-ci sait fort bien que les cibles sont insuffisantes et ne tiennent pas compte des pressions croissantes sur le système, notamment le nombre de personnes indûment hébergées à l’hôpital, en refuge et en prison[48]. Les cibles ne satisfont pas non plus les recommandations que j’avais formulées dans le rapport Dans l’impasse pour prioriser les personnes vivant dans un milieu inadéquat. Selon un(e) haut(e) fonctionnaire d’un bureau régional, le processus de planification pluriannuelle force à essayer de répondre à des « besoins illimités » au moyen de « ressources limitées ».
Pour une collaboration accrue : le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic
150 Le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, conçu conjointement par le ministère de la Santé et le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, est un autre exemple d’une approche bien intentionnée mais réactive qui, plutôt qu’une solution systémique à long terme, n’est qu’une solution de fortune temporaire. Le projet visait à faciliter la sortie d’hôpital des personnes prioritaires ayant une déficience intellectuelle et un diagnostic de trouble de santé mentale. Toutefois, on procédait surtout une personne à la fois, sans s’attarder aux obstacles systémiques.
151 Selon les ministères, le projet faisait suite à deux événements importants. Le premier était une décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario en 2020, selon laquelle le confinement d’un homme ayant d’importantes déficiences physiques, intellectuelles et psychiatriques dans un hôpital psychiatrique médicolégal pendant six ans par manque de logement approprié dans la collectivité violait son droit à la liberté prévu par la Charte canadienne des droits et libertés[49].
152 L’autre facteur important était la pandémie de COVID-19, qui a pressé les hôpitaux de libérer des lits. De haut(e)s fonctionnaires du MSAN ont dit être au courant de deux situations particulièrement « déchirantes » où des personnes ayant une déficience intellectuelle avaient passé plusieurs années à l’hôpital. Malgré la collaboration avec le MSESC, il était impossible d’obtenir des fonds suffisants ou des solutions adéquates pour ces personnes dans la collectivité. Les fonctionnaires nous ont dit savoir qu’il fallait agir.
153 En 2021, chacun des ministères s’est vu octroyer deux millions de dollars à même les budgets existants pour aider des gens à quitter l’hôpital. Chacun a reçu cinq millions de dollars pour 2022 2023, et neuf millions de dollars pour le projet en 2023 2024. Les deux ministères ont mis sur pied un « groupe de collaboration » et un groupe de travail où siégeaient des membres du personnel des deux ministères et de Santé Ontario. Initialement, le projet visait à réduire la durée des séjours des personnes nécessitant un autre niveau de soins, à prévenir les visites aux urgences évitables et à lever les obstacles systémiques dans la mesure du possible. Puis, les objectifs du projet ont gagné en précision : il s’agissait maintenant d’assurer la transition des personnes prioritaires à diagnostic mixte hors de l’hôpital, dans un milieu où elles pourraient se stabiliser.
154 Le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic était un pas positif vers la collaboration entre le secteur des soins de santé et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Les histoires de Noah, Jordan, Jack et Kevin se seraient probablement terminées bien différemment sans les fonds et le soutien obtenus par cette collaboration. Plusieurs fonctionnaires des ministères et de Santé Ontario avec qui nous avons parlé ont souligné que ce projet avait réussi à faciliter la transition des personnes sélectionnées de l’hôpital à la collectivité. Depuis 2021, au moins 34 personnes ont pu emménager dans un logement et bénéficier d’autres services comportementaux et de santé nécessaires.
155 Un(e) fonctionnaire de Santé Ontario nous a expliqué que le départ d’une seule personne pouvait permettre à l’hôpital d’accueillir des centaines d’autres patient(e)s, puisque souvent, les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins et ayant une déficience intellectuelle occupent leur lit pendant des années, un lit qui pourrait normalement assurer des soins actifs de courte durée pour des cycles de trois à cinq jours.
156 Pour les personnes touchées, les conséquences d’un long séjour à l’hôpital ne sauraient être surestimées, vu les effets négatifs de cette hospitalisation sur leur qualité de vie. Un(e) professionnel(le) d’expérience s’occupant de la gestion des cas dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle a dressé ce tableau sombre :
[Traduction]
On a ici une tragédie dans notre province qui touche ces personnes hospitalisées... Il arrive, quand je me retrouve face à ces cas, que je dise aux gens, en blaguant à peine, qu’elles seraient mieux traitées à Guantanamo que là où elles sont…[C]es gens sont dans une chambre d’hôpital, immobilisés pendant… de longues, longues périodes de temps, avec un garde de sécurité à leur porte, mais il n’y a rien qui se passe…
[C]e sont des êtres humains, des personnes qui vivent et respirent, mais la façon dont on les traite est complètement inhumaine.
Laisser les arbres cacher la forêt
157 Malgré les bons coups, le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic était limité à plusieurs égards. Il ne s’attaquait pas vraiment aux causes systémiques sous-jacentes qui font de l’hôpital le lieu de vie par défaut des personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes.
158 Dans le cadre de référence du projet, il était indiqué que les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins qui ont un diagnostic mixte restent à l’hôpital parce qu’il n’y a pas de services communautaires pour eux, ou s’il y en a, les ressources destinées aux personnes ayant des besoins complexes sont limitées. Dès le départ, le groupe de travail du projet connaissait les barrières systémiques à la transition dans la collectivité. Selon les notes d’une réunion tenue dans les premières phases du projet, un(e) membre du groupe de travail a dit que [Traduction] « la clé du succès se trouvera dans la nature systémique de l’approche de planification et de facilitation. Le problème réside en grande partie dans la capacité du système, le type de placement et le peu de ressources disponibles ».
159 Malgré tout ce que l’on savait, le projet était surtout axé sur les cas individuels, sans traiter les obstacles systémiques. Ces obstacles ont retardé et empêché la sortie hors de l’hôpital de personnes admissibles, et le projet a aidé beaucoup moins de gens que prévu. À la base, les ministères estimaient qu’ils pourraient assurer la transition d’environ 50 personnes pour juillet 2022. Or, 10 personnes seulement ont été sélectionnées dans les premières phases du projet, et en date d’avril 2022, seulement deux avaient quitté l’hôpital.
160 Les transitions ont cessé en 2022 parce que le financement de l’État était approuvé sur une base fiscale sans être annualisé, et ne pouvait permettre de trouver un logement permanent. En outre, la construction et la rénovation de logements pour répondre aux besoins individuels prenaient plus de temps que prévu, et les budgets nécessaires pour offrir du soutien dans la collectivité étaient « beaucoup plus élevés » qu’attendu.
161 Plusieurs fonctionnaires des deux ministères nous ont dit souhaiter qu’une approche plus holistique ou systémique soit appliquée dès le début, avec plus de planification et une définition claire des rôles et des responsabilités.
162 En février 2023, une présentation interne du MSAN résumait les difficultés du projet, notamment le manque de logements abordables et accessibles et de soutiens en santé mentale dans la collectivité[50]. On y recommandait de passer à une approche systémique. Un(e) fonctionnaire du MSAN participant au projet nous a dit croire que le projet faisait « beaucoup de bien » pour les personnes choisies en vue d’une transition hors de l’hôpital, mais craindre qu’« on soit toujours dans la même situation dans quelques années si on ne change rien au système ». Cette personne a ajouté que son « plus grand regret » était la nature réactive du projet et l’absence d’un « volet stratégique ».
Admissibilité restreinte
163 La visée restreinte du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic limitait aussi l’admissibilité des personnes. Les documents internes que nous avons examinés montrent que le personnel du MSESC a d’abord essayé d’élargir la portée pour inclure les personnes ayant des besoins complexes en général, mais que du point de vue du MSAN, il importait de destiner les fonds en santé à des personnes ayant un diagnostic de trouble de santé mentale. Selon les professionnel(le)s des secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avec qui nous avons parlé, seules les personnes nécessitant un autre niveau de soins qui avaient une déficience intellectuelle ainsi qu’un diagnostic officiel de trouble de santé mentale étaient admises; étaient donc exclu(e)s les autres patient(e)s de longue durée ayant des besoins complexes, qui font face à des obstacles semblables les empêchant de sortir de l’hôpital.
164 Un(e) fonctionnaire d'un bureau régional de Santé Ontario nous a dit que plus de la moitié des patient(e)s de longue durée ayant une déficience intellectuelle qui occupaient un lit affecté aux soins de santé mentale dans sa région n’avaient pas de diagnostic de trouble de santé mentale ou de consommation de substances.
165 Les personnes rencontrées nous ont expliqué que différentes raisons peuvent justifier qu’une personne ayant une déficience intellectuelle n’ait pas de diagnostic officiel de trouble de santé mentale, même si elle présente des comportements difficiles, reçoit des soins psychiatriques ou occupe une place dans un hôpital psychiatrique. Sean par exemple avait des besoins très complexes, mais pas de diagnostic de trouble de santé mentale, ce qui l’excluait du projet.
166 Les membres du personnel du MSAN avec qui nous avons parlé ont admis que les personnes sans diagnostic de trouble de santé mentale connaissent probablement les mêmes difficultés lors de leur transition dans la collectivité que celles ayant un diagnostic officiel. Un(e) autre haut(e) fonctionnaire a avancé qu’il ne devrait exister aucun obstacle à la collaboration lorsque la personne a une déficience intellectuelle mais pas de diagnostic de trouble de santé mentale si elle occupe un lit affecté aux soins de santé mentale et que cela joue sur son accès aux soins. Selon ses dires, « [n]ous sommes un seul gouvernement, et nous sommes collectivement responsables de ces personnes. »
Données limitées
167 Des fonctionnaires des deux ministères ont admis que le projet ne disposait pas de données fiables sur le nombre de personnes hospitalisées ayant un diagnostic mixte. Les chiffres de Santé Ontario et ceux des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle différaient.
168 Au début de 2023, plus d’un an après le début du projet, le MSAN a commencé à demander et à suivre les données de Santé Ontario concernant les hospitalisations à un autre niveau de soins des personnes ayant une déficience intellectuelle. Le but était d’évaluer les tendances mensuelles et d’éclairer les décisions du projet. Cependant, le personnel du MSAN nous a dit ignorer si les données concernaient uniquement les personnes à diagnostic mixte, ou si elles concernaient plus généralement les personnes ayant une déficience intellectuelle.
169 À partir des chiffres reçus de Santé Ontario, le MSAN a constaté que le nombre de patient(e)s hospitalisées nécessitant un autre niveau de soins ne diminuait pas. Un(e) fonctionnaire nous a fait la remarque suivante : « Dès que quelqu’un part, bam, quelqu’un d’autre le remplace tout de suite. » Bien que les nombres soient probablement sous-déclarés en raison des limites du système, le projet estimait initialement que plus de 70 personnes hospitalisées ayant une déficience intellectuelle étaient désignées comme des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins. En date de décembre 2024, ce nombre était passé à 124.
170 Par ailleurs, l’atteinte des différents objectifs du projet n’a pas été évaluée comme requis. Les ministères devaient préparer des « rapports sur les activités » chaque année, mais en décembre 2023, aucun n’avait encore été produit. En janvier 2025, les ministères avaient conçu un questionnaire pour sonder l’avis des organismes de services sur le processus de transition, notamment la communication, l’accès aux services cliniques et les occasions d’apprentissage. Ils comptaient le leur envoyer en 2025.
Fin du projet pilote
171 Malgré ses limites, le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic était un pas prometteur vers une réponse collaborative à cette crise. Malheureusement, les efforts semblent avoir pris fin. Le personnel du MSESC nous a dit que le gouvernement ne s’était pas engagé à investir davantage dans ce projet. Le personnel du MSESC avait demandé des fonds pour élargir le projet en 2024-2025 afin de permettre la transition de possiblement 90 personnes sur une période de trois ans. Le financement n’a pas été accordé.
172 On trouve dans les documents du MSAN et dans les propos de certain(e)s fonctionnaires une intention de miser sur des changements systémiques et sur la prévention des hospitalisations nécessitant un autre niveau de soins. Les membres du personnel du MSAN et du MSESC ont dit tenir des rencontres régulières sur les options pour prévenir et éviter les hospitalisations de longue durée en se penchant sur le système, mais aucun plan substantiel n’a été créé jusqu’à maintenant.
173 Il est important que des lits de soins actifs dans le système hospitalier de l’Ontario soient disponibles pour les personnes qui en ont besoin. Il est aussi impératif d’éviter aux personnes ayant une déficience intellectuelle l’indignité et l’épreuve d’une hospitalisation prolongée et inutile.
Planifier l’avenir : il est plus que temps
174 Un(e) fonctionnaire du MSESC nous a fait observer que le processus actuel consistant à servir une personne à la fois ne permettait pas de développer la capacité systémique nécessaire. Un(e) autre a dit qu’il faudrait idéalement planifier les logements avec services de soutien en tenant compte des besoins de cohortes de personnes sur un « horizon de plusieurs années » et à la lumière des discussions antérieures sur la planification avec les organismes de services quant à la création de solutions pour chaque personne en fonction des besoins.
175 Le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle fait l’objet de critiques depuis des années pour son style de planification réactif aux crises. Les recommandations répétées pour l’établissement d’une stratégie pour les logements avec services de soutien ciblant les personnes ayant une déficience intellectuelle sont restées sans suite. Sans une stratégie complète et intégrée fondée sur les besoins et assortie d’un plan – et des ressources et des partenariats intersectoriels nécessaires –, le système restera réactif. Les personnes handicapées continueront d’être institutionnalisées dans les hôpitaux et d’autres milieux inappropriés, en attendant que des solutions de logement convenables se matérialisent. Le projet pluriministériel dirigé par le ministère des Affaires municipales et du Logement pourrait aider à combler certaines des lacunes touchant le logement avec services de soutien, mais cela reste incertain.
176 Il est plus que temps d’adopter une approche proactive en matière de planification systémique dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
177 Aux solutions répondant aux besoins des personnes qui languissent dans le système hospitalier doit s’ajouter une stratégie systémique. Je recommande que le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé établissent une tribune conjointe pour amorcer une planification proactive du système, notamment en s’attaquant de façon prioritaire à la pénurie de logements avec services de soutien pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. Il existe déjà une panoplie d’études et de recommandations concernant les défis liés à la transition des patient(e)s de longue durée dans des logements avec services de soutien convenables dans la collectivité. Voilà qui pourra guider les ministères dans leur planification.
178 Cette tribune conjointe devrait être non pas ponctuelle, mais permanente. Elle devrait être officiellement reconnue et entretenue dans les deux ministères afin d’en garantir la pérennité. La tribune conjointe devrait être coprésidée par des représentant(e)s des deux ministères et être assortie d’un mandat, d’une composition comprenant des partenaires clés en matière de services de santé et de développement, et d’un calendrier de réunions ordinaires approuvés. Elle devrait en outre être investie du pouvoir clairement défini d’établir une stratégie pour éliminer les obstacles empêchant les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes de faire la transition dans un logement avec services de soutien adéquat dans la collectivité. À des fins de responsabilisation et de transparence, et pour favoriser son succès à long terme, la tribune conjointe devrait rendre compte aux sous-ministres de la Santé et des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, et fournir un bilan semestriel de ses progrès à mon Bureau.
Recommandation 1
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient immédiatement établir une tribune conjointe permanente pour amorcer une planification proactive du système pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. Cette tribune devrait collaborer avec tous les partenaires des services de développement et de santé nécessaires à une planification efficace. La tribune devrait entamer ses travaux dans les six mois suivant la parution de mon rapport et travailler de façon coopérative pour s’attaquer aux obstacles auxquels sont confronté(e)s les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes qui nécessitent un autre niveau de soins ou des soins de longue durée, afin qu’ils(elles) puissent faire la transition dans un logement avec services de soutien adéquat dans la collectivité. La tribune conjointe devrait faire rapport aux sous-ministres des deux ministères et devrait fournir un bilan semestriel de ses progrès à mon Bureau.
Manque de fonds d’immobilisations
179 Un obstacle à l’accès à des ressources de logement avec services de soutien dans la collectivité est le manque de fonds d’immobilisations qui permettraient de bâtir les ressources de logement nécessaires au secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Plusieurs des personnes rencontrées nous ont dit qu’il est souvent impossible de trouver des espaces en logement locatif pour les personnes ayant des besoins complexes en raison des importants travaux de rénovation nécessaires pour intégrer les dispositifs de sécurité et les autres aménagements spécialisés. Sans le financement d’immobilisations nécessaire pour créer des espaces adéquats, les options restent rares.
180 Les organismes de services ont parfois réussi à obtenir un petit financement d’immobilisations par le processus de demande de financement de renouvellement des installations partenaires du MSESC, pour des choses comme des rénovations ou réparations mineures, y compris des mises à niveau des dispositifs de santé et sécurité. Toutefois, l’un de ces organismes nous a confié qu’obtenir ce financement était « comme gagner la loterie ». Le financement d’immobilisations ciblé et adéquat pour l’achat de résidences ou les rénovations majeures est encore plus difficile d’accès.
181 Les organismes de services nous ont dit être préoccupés par ce qu’ils perçoivent comme une réticence du gouvernement à financer des espaces physiques, celui-ci leur laissant le soin d’assembler un ensemble « disparate » de fonds pour créer des logements adéquats pour les personnes ayant des besoins complexes.
182 Un organisme de services nous a rapporté avoir des terrains où bâtir des logements, mais être sans fonds d’immobilisations pour ce faire. Il a critiqué le gouvernement, prêt à débloquer les centaines de milliers de dollars nécessaires pour rénover un seul appartement pour une personne, mais réticent à consacrer le même montant à l’achat ou à la construction de nouveaux logements pouvant accueillir plus d’une personne. « [I]l devrait y avoir une vision d’avenir plutôt qu’une mentalité de gestion ponctuelle », a commenté l’organisme.
183 Comme un(e) gestionnaire de la coordination des cas complexes l’a fait observer, les réseaux communautaires de soins spécialisés font leur travail de représentation des client(e)s et de coordination des ressources de soutien, mais « au bout du compte… nous n’avons pas de logement à offrir à la personne ». Dans une demande de financement interne en version provisoire adressée au Ministère en novembre 2022 pour des éléments stratégiques et d’infrastructure liés aux services sociaux, l’allocation de fonds d’immobilisations est décrite comme réactive et fondée sur les pressions ressenties chaque année. Ce document contient la déclaration suivante[51] :
[Traduction]
Sans installations comme […] des soutiens cliniques spécialisés pour les adultes ou encore des foyers de groupe ou des milieux d’aide à la vie autonome, plus d’Ontarien(ne)s vont se faire traiter à l’hôpital ou auprès de médecins de premier recours, et vont potentiellement y demeurer plus longtemps, faute de soutiens adéquats après le traitement. Cet influx additionnel accroît la pression sur un système de services de santé déjà surchargé.
184 Un(e) des représentant(e)s que nous avons interrogé(e)s a souligné que, même s'il est clairement nécessaire de s'éloigner des structures de grands groupes qui ressemblent à l'ancien modèle institutionnel, la question de la capacité doit être abordée. Comme cette personne l’a dit, si la vision mise de l’avant dans En quête d’appartenance n’est pas soutenue par des ressources adéquates, « la quête d’appartenance ne mènera nulle part ».
185 Pour prévenir ce scénario, le MSESC devrait planifier proactivement le développement et le financement d’une infrastructure communautaire adéquate et appropriée afin de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont difficiles à servir.
Recommandation 2
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait intégrer la planification et le financement des immobilisations à la planification proactive d’un système de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, afin d’établir une infrastructure communautaire adéquate et appropriée, répondant aux besoins de ces personnes, notamment celles ayant des besoins complexes.
Financement statique et inflation des coûts
186 Le MSESC ne tient généralement pas compte de l’inflation ni de l’évolution des besoins de la personne dans ses allocations de financement pour le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Cette pratique a fini par limiter les organismes de services dans leur capacité de répondre aux besoins croissants des personnes nécessitant un logement avec services de soutien dans la collectivité.
187 Habituellement, les places vacantes dans les organismes de services sont attribuables au décès ou au déménagement d’un(e) résident(e). Les fonds et le ratio en personnel attribués aux places vacantes reflètent l’entente originale conclue avec le Ministère. Ces ententes de financement peuvent dater de plusieurs décennies et ne pas répondre aux coûts actuels liés à la dotation et aux logements, encore moins aux besoins additionnels d’un(e) nouveau(elle) résident(e).
188 De nombreux organismes de services nous ont dit être inquiets de n’avoir reçu aucune augmentation de leur financement de base depuis plus de 10 ans. Un(e) représentant(e) du Ministère a fait la déclaration suivante :
Voilà 14 ans que nous faisons fonctionner nos organismes [de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle] avec le même budget, et l’on se demande pourquoi nous n’arrivons pas à mobiliser qui que ce soit pour le développement et l’investissement dans les ressources liées à ce type de scénario… À présent, nous ne faisons que réagir aux urgences et aux crises… Je… suis à la merci des urgences chaque jour dans ma région.
189 Dans un document de 2019, le MSESC confirmait que les fonds de fonctionnement des organismes de paiements de transfert pour les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle n’avaient pas connu d’augmentation notable depuis 10 ans. Il y faisait aussi observer que les organismes de services n’avaient reçu aucun financement additionnel pour répondre aux besoins de soutien accrus de leur clientèle vieillissante[52].
190 En 2024, le MSESC a majoré d’environ 3 % le budget de base des organismes de services pour les aider à soulager les pressions inflationnistes et salariales afin de maintenir les services existants. Cette augmentation ne visait pas à répondre à des besoins additionnels ni à bâtir des ressources supplémentaires dans le système. Comme un organisme de services nous l’a confié, l’augmentation du coût de la vie « a tout englouti ».
191 Les organismes de services peuvent faire état de leurs contraintes financières au Ministère ou lui soumettre une analyse de cas afin d’obtenir des fonds additionnels, ponctuels ou permanents. L’obtention d’un tel financement dépend des ressources disponibles, et c’est souvent un remède temporaire plutôt qu’une solution permanente. Ces fonds sont souvent rares et insuffisants pour répondre aux besoins accrus des résident(e)s des logements avec services de soutien, ou à ceux d’un(e) nouveau(elle) résident(e). Si l’organisme n’obtient pas le financement additionnel que nécessitent les besoins croissants d’un(e) résident(e) à long terme, cette personne risque de devoir quitter le seul foyer et la seule communauté qu’elle a connus pendant la plus grande partie de sa vie.
192 Des représentant(e)s du Ministère et des organismes de services nous ont signalé qu’il fallait un système plus transparent pour que les organismes puissent solliciter un financement additionnel pour répondre aux besoins individuels en évolution.
193 Les pratiques actuelles du MSESC quant au financement des places vacantes et au financement de base des organismes de services dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ne tiennent pas compte de l’augmentation future des coûts, notamment par l’inflation. Ce secteur est perpétuellement en situation de rattrapage et de crise, improvisant pour trouver des remèdes et fonds temporaires. Dans le cadre de la planification proactive du système que j’ai recommandée, le Ministère devrait établir un processus transparent de négociation des financements supplémentaires en cas d’évolution des besoins d’une personne. Un tel processus prévoira des critères d’admission et décisionnels clairement définis et communiqués à l'ensemble du secteur. De plus, le MSESC devrait prévoir l’augmentation du budget des organismes de services et du coût de leurs places vacantes, et intégrer la planification nécessaire à chaque décision de financement. La planification devrait refléter des projections réalistes, et non les conditions observées par le passé.
Recommandation 3
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait intégrer la prévision financière des coûts des services des organismes et de la gestion des places vacantes à la planification proactive du système.
Recommandation 4
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait se doter d’un processus transparent pour la négociation des budgets pour répondre aux besoins accrus des personnes et des organismes de services dans le cadre de sa planification proactive du système. Ce processus devrait prévoir des critères d’admission et décisionnels clairement définis qui sont transmises à mon Bureau et diffusées dans tout le secteur.
Plus qu’une question de logement : la collaboration intersectorielle
194 À la lumière des cas que nous avons examinés, mener à bien la transition des hôpitaux à la communauté exige la présence de plusieurs facteurs. La plupart des personnes dont nous avons raconté l’histoire ici nécessitaient la collaboration du MSAN et du MSESC pour le financement du logement, des rénovations adaptées pour répondre aux besoins de santé et sécurité de la personne, et des services cliniques ou comportementaux spécialisés pendant et après la transition. Dans certains cas, étaient aussi nécessaires la collaboration et des ressources en personnel d’organismes de services privés.
195 Au fil des années, les chercheur(euse)s et les fonctionnaires du gouvernement ont reconnu la nécessité de méthodes intégrées et collaboratives pour soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment pour prévenir les hospitalisations inappropriées et faciliter la transition de l’hôpital à la communauté.
196 Par exemple, en 2017, un(e) conseiller(ère) indépendant(e) financé(e) par le MSESC et par un réseau local d'intégration des services de santé a examiné un projet pilote suivant un « modèle complexe de soins intersectoriels » et étudié les façons de soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins médicaux complexes. Il(elle) a conclu que les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent se retrouver coincées à l’hôpital ou dans des services de soins de longue durée en l’absence d’une place dans la communauté, et que les pratiques compartimentées ne règlent pas le problème :
[Traduction]
Ni le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ni le secteur de la santé ne sont en mesure, à eux seuls, de répondre aux besoins de ces personnes. Il faut plutôt une intégration énergique des ressources et des services pour soutenir ces personnes et leurs familles jusqu’à la fin de leur vie et pour prévenir les crises de santé[53].
197 Le Centre de toxicomanie et de santé mentale a publié entre 2009 et 2023 plusieurs rapports soulignant l’importance de la coopération et de la collaboration entre les secteurs des services de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin d’aider les personnes à diagnostic mixte à faire la transition de l’hôpital à la collectivité. Dans son rapport de 2019, intitulé Addressing Gaps in the Health Care Services Used by Adults with Developmental Disabilities in Ontario[54], le Centre fait état de piètres résultats cliniques chez les personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur risque accru d’hospitalisations répétées. Il souligne que pour permettre à ces personnes de quitter définitivement l’hôpital, la coordination est nécessaire entre l’hôpital et la communauté, mais aussi entre les différents secteurs et bailleurs de fonds : [traduction] « [P]arce que les adultes [ayant une déficience intellectuelle] nécessitent et reçoivent des services et du soutien des secteurs de la santé et des services sociaux, la coopération intersectorielle est essentielle […] ».
198 Plus récemment, dans son guide de pratique de 2023 intitulé Supporting alternate level of care (ALC) patients with a dual diagnosis to transition from hospital to home: Practice Guidance[55], le Centre explique l’importance d’un accès coordonné aux soins nécessaires, soit les soins pour les déficiences intellectuelles, les soins cliniques et les soins médicaux – y compris les soins primaires et les services de psychologues, de thérapeutes du comportement, de travailleur(euse)s sociaux(ales), d’infirmier(ère)s ou d’orthophonistes. Il recommande la même stratégie pour d’autres groupes, comme les personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont des besoins médicaux complexes ou qui présentent un « comportement de détresse » sans lien avec un problème psychiatrique.
La difficulté d’obtenir du soutien pour une déficience intellectuelle à l’hôpital
199 Dans bien des cas, la collaboration et les soins intersectoriels sont importants pour assurer la bonne transition hors de l’hôpital de la personne ayant une déficience intellectuelle, même quand celle-ci demeure à l’hôpital. Certains des cas exposés dans le présent rapport illustrent en quoi les services à ces personnes et les services comportementaux en milieu hospitalier peuvent aider à mitiger la perte d’aptitudes et les effets de l’institutionnalisation. Ils peuvent améliorer la qualité de vie et faciliter la communication entre les patient(e)s et le personnel de l’hôpital. Tout cela améliore les chances d’une transition réussie dans la communauté.
200 Par exemple, l’organisme de services finalement engagé pour fournir un soutien en déficience intellectuelle à Noah à l’hôpital a constaté que ce dernier n’était pas agressif à son admission à l’hôpital, mais comme il était incompris et que lui-même comprenait peu ce qui se passait, ses comportements ont « explosé » et le recours aux contentions s’est accru au fil du temps.
201 Le manque de constance dans le soutien hospitalier aux personnes ayant une déficience intellectuelle peut aussi nuire aux progrès et au bien-être de ces patient(e)s. Dans le cas de Luc, l’hôpital n’a pas renouvelé son contrat avec l’organisme de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui assurait son soutien, et alors il s’est mis à beaucoup moins manger, et l’on a observé des périodes de 24 heures où il ne mangeait rien.
202 Les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle que nous avons consultés ont souligné l’importance d’affecter à ces patient(e)s des professionnel(le)s de soutien direct dès que possible à l’hôpital. Car il faut du temps pour bâtir la confiance et la relation nécessaires pour comprendre ce que vit la personne et ce dont elle a besoin – et l’aider à devenir « prête à vivre dans la collectivité ».
203 Malheureusement, il n’existe aucun mécanisme, ni au MSAN ni au MSESC, qui permettrait de financer un accès constant, rapide et équitable à ces services. Des fonctionnaires du MSESC nous ont dit qu’habituellement, la personne hospitalisée avait besoin d’un plan de transition et d’un organisme s’occupant pour elle de planifier activement l’obtention de fonds et d’un accès à des services pour les déficiences intellectuelles à l’hôpital. Comme le démontrent les cas dans le présent rapport, la recherche d’un organisme de services disposé et apte à soutenir la transition dans un logement avec services de soutien peut prendre des mois. Même lorsqu’un organisme intervient, celui-ci peut ne pas avoir un effectif suffisant pour fournir des soins à l’hôpital.
204 Les personnes soutenues financièrement par le programme Passeport peuvent utiliser ces ressources pour engager un(e) professionnel(le) de soutien direct. Toutefois, comme cela s’est produit dans le cas de Jordan, même le montant maximal s’avère souvent insuffisant pour couvrir le soutien nécessaire lors d’une hospitalisation prolongée. Une complication supplémentaire est que certains hôpitaux interdisent au personnel de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et aux organismes externes d’assister les patient(e)s.
205 Cette mosaïque de pratiques disparates fait que le soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle peut varier beaucoup d’un cas à l’autre. Par exemple, Luc et Noah étaient hospitalisés dans la même aile, durant la même période, et bien que tous deux aient eu des périodes sans ce type de soutien, Luc recevait parfois des services comportementaux à plein temps et l’assistance 24 heures sur 24 de deux membres du personnel de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Or, Noah n’avait accès qu’à un(e) travailleur(euse) de soutien en déficience intellectuelle, six heures par jour, malgré son évaluation faisait état de besoins plus élevés. Un organisme de services au fait de cette situation nous a dit estimer que cela reflétait une allocation de ressources inéquitable.
Soutien clinique et comportemental à titre permanent
206 L’offre d’un soutien clinique adapté pendant et après la transition hors de l’hôpital est souvent un facteur important pour le succès et la viabilité de la transition des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes vers la collectivité. Un organisme de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle nous a dit que l’expertise clinique, comme la consultation en comportement et les services dans la collectivité, peut contribuer à la sécurité de la personne, du personnel de soutien et des autres personnes habitant dans le milieu de vie lors des périodes de crise, ce qui peut prévenir les interventions policières et les réadmissions à l’hôpital. Il a aussi dit que, lorsque la personne n’a pas accès à un(e) médecin, l’organisme peut devoir retourner au service d’urgence simplement pour renouveler une prescription.
207 La coordination entre le MSAN et le MSESC peut aider à garantir l’accès à des services financés de soutien clinique de transition. Par exemple, dans le cas de Sean, son état est tout simplement ingérable dans la collectivité sans le soutien quotidien d’infirmier(ère)s et d’autres professionnel(le)s de la santé. Noah, Luc et Kevin ont eu besoin d’un soutien psychiatrique et comportemental pour faciliter leur transition de l’hôpital à la collectivité. Malheureusement, d’après plusieurs témoins que nous avons rencontré(e)s, le niveau de participation du MSAN et les services spécialisés de soutien clinique et comportemental qu’ils ont reçus tout au long du processus de transition étaient inhabituels, voire inédits.
208 Exception faite du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic et du Programme de réadaptation et de soutien transitoire au logement pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic[56] pour les client(e)s de psychiatrie médicolégale, la collaboration pour servir des personnes dont les besoins recoupent les deux systèmes demeure limitée. Les deux ministères ont un protocole d’entente sur les soins exceptionnels pouvant être utilisé pour fournir des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins élevés et complexes. Dans le protocole d’entente, on insiste sur l’importance particulière d’une collaboration et d’une intégration des services accrues pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, afin que les services soient [traduction] « disponibles et accessibles là et quand c’est nécessaire ».
209 Malgré cette entente, la collaboration interministérielle visant à soutenir et à aider financièrement ces personnes tend à demeurer limitée et ponctuelle.
210 Depuis 2015, les ministères n’ont collaboré que pour aider financièrement cinq personnes dans le cadre du protocole d’entente. L’une de ces personnes avait une déficience intellectuelle, était sourde-aveugle et était devenue incapable de marcher après être restée dans un lit d’hôpital pendant un an en raison d’un soutien et de soins médicaux insuffisants dans la collectivité. L’homme a finalement reçu l’aide financière nécessaire au soutien dont il avait besoin pour réintégrer la collectivité grâce à une entente de soins exceptionnels, mais seulement après l’intervention d’un(e) haut(e) dirigeant(e) d’un organisme de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ayant plaidé auprès du MSESC pendant des semaines pour une solution de financement qui aiderait cet homme à quitter l’hôpital.
211 Cet organisme a également pu répondre aux besoins complexes de l’homme sur le plan médical et quant à sa déficience intellectuelle, car c’est l’un des rares organismes offrant ce type de services en Ontario qui engage directement des spécialistes de soins médicaux et comportementaux et les attache à ses services de soutien. Seize de ces organismes font partie du réseau de services cliniques spécialisés aux personnes ayant une déficience intellectuelle; ils ne reçoivent habituellement pas de fonds du ministère de la Santé, mais viennent souvent en aide à des personnes médicalement fragiles ou qui nécessitent un soutien comportemental intensif.
212 D’autres organismes de services nous ont parlé des problèmes d’accès aux services de soutien clinique des hôpitaux pendant la transition ou après la sortie de l’hôpital, et d’une absence généralisée de soins intégrés centrés sur la personne. Quelqu’un de la direction d’un organisme de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle a fait observer que certains hôpitaux ont donné suite à des demandes de continuité du soutien clinique après le départ de l’hôpital, alors que d’autres n’ont pas voulu ou n’ont pas pu le faire. Certain(e)s ont parlé d’une « ligne de démarcation aux portes de l’hôpital ». Une fois le(la) patient(e) sorti(e) de l’hôpital, le soutien clinique prend fin. Cela peut causer des hospitalisations répétées et évitables, ou contribuer à l’échec d’un plan de services de soutien.
Ne pas coordonner, c’est planifier l’échec
213 Les guides internes du MSESC sur l’administration du processus de planification pluriannuelle des services de soutien insistent sur l’importance pour les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle de bâtir ou de mettre à contribution leurs liens avec des partenaires du secteur, comme les partenaires locaux en santé, les équipes de Santé Ontario et les agences communautaires de services de santé mentale[57]. Or, plusieurs fonctionnaires du MSESC ainsi que des représentant(e)s des secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle nous ont dit que ce n’est pas habituellement ce qui se produit dans la pratique, que ce soit au moment de prévenir l’hospitalisation, pendant l’hospitalisation, lors du processus de transition ou après le départ de l’hôpital.
214 En 2020, dans un rapport[58] adressé au MSESC sur l’amélioration de l’efficacité des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, KPMG a constaté l’absence d’un réseau formel permettant l’intégration des services dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou entre ces services et les services connexes comme les soins de santé.
215 En 2021, le MSESC a déclaré dans des documents internes qu’il n’avait toujours pas conclu avec le ministère de la Santé d’entente viable de partage des coûts qui permettrait des conventions de financement collaboratif[59]. La même année, des membres de l’équipe des politiques du MSESC ont préparé une présentation sur [Traduction] « les obstacles à l’accès aux services de santé », faisant observer que la pandémie de COVID-19 avait exacerbé les difficultés propres aux services de santé et de santé mentale[60]. On expliquait dans cette présentation que la pandémie avait fait ressortir des problèmes systémiques tels que la carence des relations entre les différents secteurs et l’absence de prévention et d’un soutien proactif. Tout en reconnaissant que le MSESC travaillait avec le MSAN pour sortir des hôpitaux les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et nécessitant un autre niveau de soins, l’équipe des politiques faisait entendre que des solutions plus préventives pourraient être nécessaires.
216 Des professionnel(le)s de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle que nous avons rencontré(e)s ont reconnu la nécessité de solutions plus intégrées pour favoriser le succès des transitions de l’hôpital à la collectivité des personnes ayant des besoins complexes. Des fonctionnaires du MSESC ont dit que le MSAN pourrait jouer un plus grand rôle dans l’accès au soutien clinique, notamment aux services de santé mentale. Un(e) fonctionnaire du MSAN était d’accord pour dire que sans services communautaires, notamment sans soutien en santé mentale, la sortie d’hôpital sera probablement suivie d’une réadmission. D’autres ont convenu que le MSAN pourrait participer au financement du soutien transitionnel, mais ont fait la mise en garde qu’il faudrait davantage de recherches. Selon eux(elles), il faut une meilleure connaissance du profil et des besoins des personnes hospitalisées pour une durée prolongée et de meilleures données sur le nombre de personnes touchées.
217 S’il est important de disposer de données précises sur la demande pour ces services, la nécessité de soutiens intégrés dans l’ensemble des secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle n’a rien de nouveau. En 2008, la Directive stratégique conjointe pour la prestation de services communautaires de santé mentale et de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des troubles jumelés[61] présentait une vision pour la prestation de services intégrés, coordonnés et proactifs à ces personnes et à leurs familles. Les soins intégrés doivent aller plus loin que la santé mentale. En 2012, à la suite d’un examen provincial des programmes pour les personnes à diagnostic mixte[62], KPMG proposait une intégration accrue des soins, notamment l’établissement d’un modèle communautaire. KPMG recommandait que l’hôpital soutienne les services communautaires, le partage des ressources et des renseignements, des lits virtuels, des équipes de services mobiles et de sensibilisation, des services conjoints et un comité de soins tertiaires pour les personnes à diagnostic mixte chargé de superviser et de favoriser une [Traduction] « approche stratégique intégrée ».
218 En 2018, dans une présentation[63], le MSESC a abordé plusieurs stratégies à court et à long terme pour mieux intégrer les services. Parmi les solutions envisagées, l’expansion du rôle des professionnel(le)s de la santé pour mieux servir les personnes ayant une déficience intellectuelle dans des secteurs comme les soins primaires, les soins infirmiers et les soins à domicile, la promotion des ressources communautaires par un investissement dans des programmes de perfectionnement des professionnel(le)s de la santé, et l’établissement d’un engagement officiel entre les bureaux régionaux du MSESC et les réseaux locaux d’intégration des services de santé (qui font aujourd’hui partie de Santé Ontario).
219 En 2021, un réseau local d’intégration des services de santé a mis au point un projet de modèle clinique et de cadre de référence pour les personnes à diagnostic mixte, en réaction aux cas préoccupants de deux patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui étaient hospitalisé(e)s depuis longtemps. Ce cadre avait pour but de créer un modèle idéal de soins et de cheminements pour les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins ou les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui présentent un risque d’hospitalisation. Y était envisagé un modèle de soins multiorganisationnels dans la collectivité, pris en charge par un noyau de professionnel(le)s, afin d’aider à prévenir les hospitalisations et de rompre avec les soins « compartimentés ». D’autres rapports et mémoires soumis au MSESC présentaient la recommandation d’une semblable stratégie « multidisciplinaire ».
220 En dépit de l’importance universellement reconnue et documentée de l’intégration et de la collaboration entre les secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, les systèmes continuent en grande partie de fonctionner isolément. Tout au long de cette enquête, nous avons entendu des professionnel(le)s et des représentant(e)s des deux secteurs dire que les services et les soutiens demeurent fragmentés et « en silos », et que cela constitue un obstacle important à la transition des personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes vers la collectivité.
221 Des témoins de chaque secteur nous ont parlé de la friction qui survient en l’absence d’une vision commune relativement aux besoins des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle. Des professionnel(le)s du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle disent que « très souvent, on se renvoie la balle » quand les deux ministères sont concernés, qu’on entend « ce n’est pas mon problème », qu’il y a une « mentalité de silos » et qu’il n’y a « aucune vision normalisée selon laquelle nous faisons ce travail ensemble ».
222 J’ai déjà recommandé que le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé établissent une tribune conjointe permanente pour collaborer dans la planification pour ce secteur. Cette tribune devrait aussi travailler à la définition et à l’implantation de services et soutiens intégrés dans l’ensemble des secteurs des services de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour prévenir les hospitalisations inutiles et soutenir les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle à l’hôpital ainsi que pendant et après leur transition dans la collectivité.
Recommandation 5
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient travailler ensemble, par la tribune conjointe dont il est question dans la recommandation 1, pour définir et mettre en œuvre une stratégie intégrée et un cadre de soins approprié pour la prestation de services et de soutiens dans l’ensemble des secteurs des services de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin de prévenir les hospitalisations inutiles et de soutenir les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes à l’hôpital ainsi que pendant et après leur transition dans la communauté.
223 Les deux ministères devraient aussi donner davantage de directives aux hôpitaux et aux organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle concernant l’importance de ces services et soutiens pour les patient(e)s hospitalisé(e)s et de la prestation du soutien clinique, y compris la formation clinique nécessaire pour ces organismes, pendant la transition et après la sortie de l’hôpital. La tribune conjointe dont j’ai recommandé l’établissement aux ministères devrait travailler à éliminer les actuels obstacles qui empêchent les patient(e)s de recevoir les services directs nécessaires pendant leur hospitalisation et à soutenir le soutien clinique nécessaire à la transition réussie des patient(e)s vers la collectivité.
Recommandation 6
Par la tribune conjointe dont il est question dans la recommandation 1, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient viser à assurer aux patient(e)s ayant une déficience intellectuelle l’accès au soutien nécessaire à l’hôpital et à du soutien clinique pendant et après la transition vers la communauté.
Recadrer la Directive stratégique conjointe pour les personnes à diagnostic mixte
224 L’idée de faire travailler ensemble les ministères pour améliorer les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle n’a rien de neuf. Il existe depuis des années une directive stratégique voulant que les ministères orchestrent leur travail pour mettre sur pied des soutiens intégrés pour les personnes à diagnostic mixte et en faciliter l’accès. Le MSAN et le MSESC ont initialement rédigé une Directive stratégique conjointe pour la prestation de services communautaires de santé mentale et de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des troubles jumelés à la fin des années 1990. La dernière mise à jour officielle remonte à décembre 2008.
225 La Directive visait à renforcer les ressources communautaires pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle et ayant reçu un diagnostic en santé mentale. Cette directive pose parmi ses « hypothèses de base » que la collaboration intersectorielle est essentielle à tous les niveaux pour fournir les services appropriés. Toutefois, la plupart des représentant(e)s du MSAN et du MSESC que nous avons consulté(e)s au sujet des mesures adoptées pour réaliser les objectifs de la Directive de 2008 n’ont su nommer aucune mesure concrète ou connaissaient peu le document en question.
226 Même si son intention était bonne, la Directive n’a pas atteint l’objectif fixé. D’après la documentation[64] du Ministère, une évaluation de la Directive menée en 2012 a révélé l’absence d’un engagement ministériel commun, des rôles et orientations mal définis et l’absence de responsabilisation ou de structures pour en assurer la bonne mise en œuvre. Il était recommandé dans l’évaluation de créer un cadre interministériel pour améliorer la coordination des soutiens aux personnes à diagnostic mixte et pour renforcer la responsabilisation.
227 Entre 2013 et 2015, le personnel des deux ministères ainsi que divers(es) expert(e)s en santé, en diagnostic mixte et en déficience intellectuelle ont travaillé ensemble au sein d’un groupe de travail sur le cadre stratégique concernant les doubles diagnostics pour réviser la Directive et créer un nouveau cadre. Ce groupe a achevé une version provisoire en 2015. Il ne l’a toutefois jamais publiée, et les révisions se sont poursuivies, débouchant sur une deuxième version provisoire en 2017, laquelle renfermait la déclaration suivante [Traduction] : « Les ressources actuelles ont besoin d’être réévaluées et transformées afin d’offrir des services harmonisés, proactifs et fondés sur des éléments probants, comme il se doit. » Ici encore, on insistait sur la nécessité de soutenir la transition des patient(e)s sortant d’un hôpital ou d’un autre établissement, et sur l’établissement de protocoles pour que les organismes de services travaillent ensemble afin d’offrir de tels services.
228 D’après les dossiers du MSESC, les deux ministères ont avalisé la version 2017 du cadre « à des fins de participation ». Toutefois, ils l’ont essentiellement mise de côté. Un document interne du MSESC, daté de 2018[65], laisse entendre que les ministères n’ont pas publié le cadre proposé parce qu’ils croyaient que grâce aux 3,8 milliards de dollars que le gouvernement s’était engagé à investir dans le secteur sur 10 ans, ils pourraient régler les problèmes d’accessibilité et d’intégration en créant un « réseau de services complet et interrelié ». Le MSESC prévoyait qu’il y aurait éventuellement « une version du cadre pour les personnes à diagnostic mixte », mais des questions demeuraient quant à savoir comment il serait « recalibré ».
229 Des courriels au sein du Ministère indiquent qu’en janvier 2022, un(e) haut(e) dirigeant(e) du MSAN a communiqué avec son homologue du MSESC pour discuter d’une nouvelle version du cadre. Les ministères ont fini par assigner la tâche de mettre à jour le document au groupe de travail chargé du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic. Toutefois, ce travail restait en cours au début de 2025.
230 L’absence de rôles et responsabilités clairement définis dans les deux ministères reste une source de problèmes. Les fonctionnaires du MSAN nous ont particulièrement souligné l’importance de clarifier les rôles respectifs des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et du secteur de la santé avant de tenter de combler les lacunes du système. Nous avons examiné un échange de courriels entre les ministères au sujet de l’indisponibilité de soutien psychiatrique pour la transition des patient(e)s quittant l’hôpital. Le personnel du MSAN a répondu en disant que son Ministère ne s’était aucunement engagé à faire suivre par des psychiatres les patient(e)s retourné(e)s dans la communauté, laissant entendre que si un hôpital acceptait de le faire, ce serait une « négociation locale ». À quoi le personnel du MSESC a répondu : « J’imagine que c’est là qu’un cadre [pour les personnes à diagnostic mixte] serait utile… ? »
231 Pour faciliter la collaboration et la planification au niveau individuel et systémique, je recommande au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et au ministère de la Santé de travailler ensemble avec la priorité de mettre à jour, de publier et de mettre en œuvre le cadre pour les personnes à diagnostic mixte.
Recommandation 7
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient se donner comme priorité de travailler ensemble pour mettre à jour, publier et mettre en œuvre la Directive stratégique conjointe pour la prestation de services communautaires de santé mentale et de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des troubles jumelés.
232 Comme l’ont démontré les limites du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, il existe bien des raisons expliquant pourquoi une personne ayant une déficience intellectuelle et nécessitant un autre niveau de soins peut ne pas avoir reçu de diagnostic de santé mentale en bonne et due forme, même si elle a des besoins complexes similaires. Les ministères devraient étendre le cadre aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes n’ayant pas reçu de diagnostic officiel en santé mentale.
Recommandation 8
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient étendre l’application de la Directive stratégique conjointe pour la prestation de services communautaires de santé mentale et de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des troubles jumelés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes n’ayant pas reçu de diagnostic officiel en santé mentale.
Derrière le rideau : le mystère des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
233 Il est difficile d’offrir un plan intégré de transition centré sur la personne pour assurer une transition réussie de l’hôpital à la collectivité quand le système des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle est peu connu dans le secteur de la santé.
234 Des professionnel(le)s des deux secteurs nous ont dit que le mystère entourant le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle contribue à l’hospitalisation inappropriée et prolongée d’adultes ayant une déficience intellectuelle. Ils(elles) ont dit de ce système qu’il est excessivement complexe, opaque et labyrinthique. Un(e) employé(e) expérimenté(e) d’un hôpital a précisé qu’il lui avait fallu accumuler ses connaissances au cas par cas, sans aucun accompagnement. En fait, certain(e)s membres de personnel hospitalier que nous avons rencontré(e)s ne connaissaient ni le système des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ni les Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI).
235 Une professionnelle d’hôpital s’étant occupée de Jordan a rapporté qu’il était son premier patient nécessitant un autre niveau de soins, et qu’elle ignorait ce qu’étaient les SOPDI et pourquoi il était important de les aviser du cas de Jordan. Les personnes qui travaillaient à la réintégration de Jack dans la collectivité nous ont dit qu’elles pensaient avoir bien fait leur travail : après plusieurs années passées à l’hôpital, elles avaient réussi à l’inscrire au registre des logements avec services de soutien des SOPDI. C’est seulement des années plus tard qu’elles ont appris que l’inscription sur la liste n’était que la première étape et que l’accès à ces services était un processus de plusieurs années.
236 Un(e) chercheur(euse) en santé ayant de l’expérience dans les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et dans le système de santé a fait observer que les résultats dépendaient beaucoup de la présence d’une personne connaissant le système qui soit là pour agir au nom du(de la) patient(e) :
[L]es chemins et les moyens d’accéder aux ressources… sont souvent très peu clairs ou absents, ou simplement très variables. Le résultat : ce sont souvent les personnes bien représentées – par quelqu’un de la famille, à l’hôpital ou dans le secteur communautaire… qui se trouve à être capable de bien plaider en faveur de la personne, à avoir quelque connaissance du système ou à avoir de bonnes relations avec des gens du système – qui obtiennent de meilleurs résultats… Et je trouve cela… très fâchant.
237 Beaucoup de professionnel(le)s médicaux(ales) et de travailleur(euse)s sociaux(ales) d’hôpital que nous avons rencontré(e)s nous ont dit qu’ils(elles) aimeraient être mieux informé(e)s et formé(e)s au sujet de la planification et des processus de financement des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Toutefois, certain(e)s représentant(e)s du MSAN estiment qu’une telle formation pourrait s’avérer peu réaliste dans le cas du personnel des unités d’urgence, vu la nature urgente de leurs tâches et parfois la charge de travail qui y est associée.
238 Des membres du personnel de Santé Ontario nous ont dit que pendant la pandémie, de nombreux hôpitaux ont perdu des employé(e)s d’expérience qui connaissaient bien le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment des planificateur(trice)s de fin de séjour hospitalier et des coordonnateur(trice)s de soins. Un(e) membre du personnel régional de Santé Ontario a dit assister actuellement à « un véritable échec » des communications entre les hôpitaux et les SOPDI.
239 Les SOPDI ont périodiquement envoyé de l’information et des affiches aux hôpitaux. En 2023, ils ont amorcé l’établissement d’une stratégie de communication pour les hôpitaux. En mars 2024, les SOPDI ont posté de l’information à 239 hôpitaux concernant leur rôle et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, en ciblant les travailleur(euse)s sociaux(ales) et d’autres membres du personnel hospitalier bien placé(e)s pour diffuser l’information. Ils ont aussi fourni de l’information à d’autres équipes et professionnel(le)s de soins de santé, y compris l’Association des hôpitaux de l’Ontario, qui a transmis l’information à ses 3 875 membres. De plus, les bureaux locaux des SOPDI font leur propre sensibilisation et donnent des présentations au personnel des soins de santé.
240 En réponse à mon rapport intitulé Dans l’impasse, le MSESC a aussi distribué de l’information aux hôpitaux au sujet du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, y compris les coordonnées des SOPDI. Cependant, d’importantes lacunes persistent dans la diffusion des connaissances entre ces services et le secteur de la santé.
241 Des membres du personnel des communications des SOPDI nous ont dit avoir fait un travail de sensibilisation, d’éducation et de soutien auprès du secteur de la santé, mais la collaboration n’est habituellement présente que s’il y a un(e) champion(ne) de ces services à l’hôpital. Ils(elles) ont souligné que ces contacts sont précieux lorsqu’il s’agit de discuter des scénarios pour des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui nécessitent un autre niveau de soins, affirmant que la communication et l’établissement de relations au niveau individuel entre les soins de santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle demeurent un élément important.
Manque de transparence
242 De plus, l’absence de renseignements précis sur les soutiens et services disponibles neutralise les efforts de transition des patient(e)s vers des milieux appropriés dans la collectivité.
243 Un(e) haut(e) dirigeant(e) d’un hôpital travaillant dans l’unité de santé mentale d’un grand hôpital nous a dit que le manque de transparence sur les délais d’attente pour un logement avec services de soutien nuit à l’hôpital dans la planification des soins ou d’une transition vers un milieu adéquat, soulignant que « personne ne devrait avoir à vivre dans un hôpital ». Et, vu le peu de ressources et d’information sur les délais d’attente et les espaces vacants dans les logements avec services de soutien au sein de la collectivité, semble-t-il que les hôpitaux sont obligés d’envisager des solutions « horribles ».
244 Le(la) haut(e) dirigeant(e) a donné comme exemple les cas de deux hommes dans la vingtaine vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. L’un était hospitalisé depuis plus d’un an, l’autre depuis plusieurs mois. Dans un cas, l’hôpital faisait son possible pour faire transférer le jeune homme dans un foyer de soins de longue durée pour aîné(e)s – une solution horrible, mais « meilleure que l’hospitalisation pour une durée indéterminée ». Quant à l’autre homme, l’hôpital envisageait son transfert dans un refuge, malgré la « détresse morale » que cette solution suscitait chez le personnel de l’hôpital, car l’homme était incapable de s’occuper de lui-même sans un solide service de soutien.
245 Le(la) haut(e) dirigeant(e) a suggéré que le MSESC publie sur son site Web le nombre de personnes qui attendent un logement avec services de soutien dans la collectivité et le nombre de places devenant disponibles chaque mois, de sorte que les hôpitaux puissent mieux planifier et gérer les attentes des familles.
246 D’autres administrateur(trice)s d’hôpitaux nous ont rapporté que, vu le peu d’information disponible sur les services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, il leur arrive souvent de se tourner vers les agences ou refuges privés parce que ce sont les seules ressources qu’ils(elles) peuvent trouver. Un(e) représentant(e) du secteur de la santé a décrit les solutions offertes par le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en parlant d’une « boîte noire ». D’autres, y compris des membres expérimenté(e)s du personnel d’organismes offrant ces services, ont usé d’expressions semblables, parlant de ce système comme d’un « trou noir » ou d’un « système caché ». Un(e) professionnel(le) a fait l’analogie avec le Magicien d’Oz en disant que ces services se trouvaient « derrière le rideau ».
247 Interrogé(e)s sur le manque de transparence quant à la disponibilité des logements avec services de soutien et des autres services aux personnes ayant une déficience intellectuelle dans la collectivité, des fonctionnaires du MSESC ont dit qu’il était difficile de communiquer des renseignements précis parce que la base de données des SOPDI est limitée, les priorités changent sans cesse en réaction aux crises et les listes de noms continuent de s’allonger dans les registres.
248 On constate un manque semblable d’information facilement accessible au sujet des logements avec services de soutien financés par le MSAN. Comme l’a fait remarquer la vérificatrice générale de l’Ontario, le MSAN ne recueille pas de renseignements sur les listes et délais d’attente pour les logements avec soutien qu’il finance. Le MSAN a déclaré que certains de ces logements peuvent servir aux personnes à diagnostic mixte. Des renseignements supplémentaires sur les logements qui accueillent ces personnes et les délais d’attente aideraient le personnel qui planifie la transition.
249 Bien qu’il puisse être difficile d’identifier les logements avec services de soutien disponibles à un moment donné, Le MSEC et le MSAN devraient publier des informations pertinentes sur le nombre de personnes sur les listes d'attente pour les options de vie autonome avec soutien destinées aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à diagnostic mixte, sur les délais d'attente potentiels, le nombre de places vacantes annuelles et le nombre de personnes desservies par chaque type de logement avec soutien. La transparence est cruciale si nous voulons que les partenaires du système planifient ensemble la transition des personnes piégées dans un hôpital vers un logement et des soutiens adéquats et opèrent cette transition aussi rapidement que possible.
Recommandation 9
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient publier sur leurs sites Web des renseignements pertinents, mis à jour annuellement, concernant le nombre de personnes sur les listes d’attente pour les logements supervisés financés par les ministères, les délais d’attente potentiels, le nombre de places vacantes annuelles et le nombre de personnes desservies par chaque type de logement supervisé financé.
250 Le peu de disponibilité des logements avec soutien adéquats et des autres services nécessaires constitue un obstacle important à la transition dans la communauté pour les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui nécessitent un autre niveau de soins ou qui sont en séjour de longue durée. Cependant, mieux informer et former les partenaires du secteur hospitalier sur le système des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment en ce qui concerne les solutions de logements avec soutien et les autres services, aurait pour effet de mieux préparer les administrateur(trice)s des hôpitaux et les autres professionnel(le)s de la santé à planifier la sortie de l’hôpital. Je sais que les SOPDI ont fait des efforts de ce côté. Toutefois, pour compléter cette initiative et y donner suite, la tribune conjointe des ministères que j’ai recommandée devrait superviser l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme permanent d’information et de formation. Ce programme devrait être axé sur la communication d’information concernant les ressources, les programmes et les processus du système des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour aider les administrateur(trice)s des hôpitaux et les autres partenaires à planifier la transition des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle dans la communauté.
Recommandation 10
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé, par la tribune conjointe dont il est question à la recommandation 1, devraient travailler ensemble à l’élaboration et à la mise en œuvre, pour le secteur de la santé, d’un programme permanent d’information et de formation axé sur la communication d’information concernant les ressources, les programmes et les processus des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à diagnostic mixte, afin de faciliter la planification de la transition des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle hors de l’hôpital.
Communication et collaboration
251 Plusieurs témoins ont insisté sur l’absence de protocoles officiels encadrant la communication entre les partenaires de santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, une situation qui se traduit souvent par une inconstance dans la communication et sape les efforts collaboratifs.
252 Un(e) haut(e) fonctionnaire du MSAN a expliqué qu’à défaut d’un processus de communication normalisé, la réussite de la collaboration entre la santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle repose généralement sur les « personnalités et les personnes ayant nourri les liens » – et prend fin quand le personnel change. Il(elle) a ajouté que même si le MSAN et le MSESC s’efforcent de collaborer, notamment par le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, il reste à établir des structures officielles, des politiques et des lignes directrices.
Une place au comité de planification
253 Les mécanismes en place qui pourraient faciliter la communication et la collaboration intersectorielles manquent d’uniformité et excluent souvent des partenaires clés. Il y a notamment la participation des partenaires de santé aux comités de planification communautaires qui est inégale dans la province. Des fonctionnaires du MSESC nous ont dit que certains comités avaient réussi à inclure les partenaires de santé dans le processus de planification, mais pas tous.
254 Des membres du personnel hospitalier planifiant les soins et la sortie des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle nous ont dit ne pas avoir été invité(e)s aux réunions des comités de planification, tandis que des membres du personnel ministériel et des organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ont affirmé que certains partenaires de santé ne se présentaient pas même quand ils étaient invités.
255 Dans le cas de Jack, les membres du personnel hospitalier s’occupant de lui et de la planification de sa sortie ne siégeaient pas au comité de planification, et donc ignoraient que les organismes de services écartaient le dossier depuis des années parce qu’ils pensaient être incapables de gérer la compulsion de Jack de boire de l’eau. Si les membres du personnel hospitalier avaient été présent(e)s, ils(elles) auraient pu expliquer ce qu’il y avait de positif chez Jack et comment l’hôpital avait réussi à gérer ce comportement. À leur avis, les organismes siégeant à ces comités doivent voir plus que le nom de la personne. Un(e) responsable d’un organisme de services avec qui nous avons parlé a confirmé l’importance pour un comité de planification d’inclure ceux et celles qui connaissent la personne concernée. Sinon, a-t-il(elle) relevé, les organismes de services s’appuient sur « ce qui est écrit » pour prendre des décisions; or certains cas paraissent très compliqués sur papier.
256 Généralement, plus les besoins de la personne semblent élevés, plus les organismes de services hésitent à se proposer. Par exemple, dans le cas de Noah, les SOPDI ont réévalué le soutien nécessaire en fonction de ses comportements et de ses besoins médicaux alors qu’il avait déjà passé presque un an à l’hôpital, et très souvent sous contention. La conclusion a été que ce patient avait besoin du niveau de soutien le plus élevé – quelque chose que les SOPDI et le personnel de gestion des cas ont dit n’avoir jamais vu auparavant. Un organisme de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui connaissait Noah a indiqué qu’il s’agissait d’un cas trop lourd pour les organismes de services. Or, il aurait été important d’avoir au sein du comité quelqu’un connaissant Noah, qui puisse expliquer que l’évaluation ne reflétait pas les comportements de celui-ci quand il vivait dans la collectivité, où il était plus autonome.
257 Quelques fonctionnaires du MSESC et des membres du personnel des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ont convenu qu’il serait avantageux que les comités de planification des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comptent des membres du personnel hospitalier connaissant les patient(e)s.
258 Également, des responsables des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avec qui nous avons parlé ont souligné l’importance d’assurer la représentation du secteur et sa participation active aux discussions de l’équipe Santé Ontario pour que les enjeux touchant les personnes ayant une déficience intellectuelle puissent être mis en avant et examinés. L’un(e) de ces responsables a expliqué ainsi la nécessité de cette collaboration :
Si nous ne siégeons pas aux comités de planification de Santé Ontario, et s’ils(si elles) ne siègent pas non plus aux comités de planification et de priorisation des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, alors il sera vraiment difficile d’élaborer des trajectoires et des processus systémiques uniformes à l’échelle de la province.
259 D’un autre côté, les fonctionnaires du MSAN avec qui nous avons parlé ont remis en question l’utilité réelle d’une présence dans les équipes Santé Ontario des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, étant donné les priorités concurrentes et la portée des enjeux médicaux traités par ces équipes.
260 Il a déjà été recommandé d’accroître la participation intersectorielle aux comités de planification. En 2023, le Centre de toxicomanie et de santé mentale a recommandé l’établissement d’un protocole uniforme dans toutes les régions des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour que le personnel hospitalier puisse assister aux réunions des comités de ce secteur, en particulier celles qui visent l’établissement des priorités, où l’on discute proactivement des patient(e)s actuel(le)s et futur(e)s nécessitant un autre niveau de soins[66]. La même année, le Groupe de travail relevant du Réseau provincial des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle a formulé des recommandations semblables[67]. Le Réseau a constaté que l’absence d’un cadre officiel ou uniforme permettant une communication régulière entre les fournisseurs de services de santé, les entités de planification et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle limitait la possibilité d’une collaboration efficace propre à induire des solutions destinées aux patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins qui ont une déficience intellectuelle.
261 Parce que toutes les parties intéressées ne sont pas systématiquement incluses dans les forums intersectoriels, des occasions d’échanger des renseignements importants sont perdues, et dans certains cas, des séjours hospitaliers se prolongent inutilement. Pour assurer une collaboration intersectorielle constante, il faudra un encadrement ministériel plus serré.
Élaboration d’un protocole commun
262 Les partenaires des deux secteurs – la santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle – ne s’entendent pas toujours sur les tenants et les aboutissants d’une collaboration structurée. Néanmoins, les personnes avec qui nous avons parlé estimaient généralement qu’une planification efficace pour les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui nécessitent un autre niveau de soins ou des soins de longue durée doit reposer sur un processus de communication et de collaboration officiel et normalisé.
263 Certain(e)s des membres du personnel hospitalier avec qui nous avons parlé ont aussi souligné le contraste qui existe entre le vague processus de planification de la transition des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et les systèmes en place pour la transition des patient(e)s vers les soins de longue durée ou les services de traitement des dépendances. Quelques-un(e)s ont dit qu’il serait utile d’encadrer le processus de transition par des ententes normalisées ou par un protocole d’entente entre les hôpitaux et les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin de prévoir un engagement de collaboration, d’établir les étapes pour préparer la transition, de dresser un plan d’intervention selon les pires scénarios et de désigner les membres de l’équipe de transition.
264 Par conséquent, je recommande que, par la tribune conjointe dont j’ai recommandé la création, les deux ministères élaborent un protocole officiel encadrant la communication et la participation aux discussions concernant les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle. Ce protocole prévoira l’envoi d’un avis aux SOPDI quand ces personnes sont admis(es) à l’hôpital et quand elles deviennent des patient(e)s de longue durée ou nécessitant un autre niveau de soins. Il comprendra également un cadre de communication pour les discussions sur la planification des transitions et des sorties d’hôpital. Les rôles et responsabilités des partenaires de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que les attentes à leur égard y seront clairement définis, et la participation des membres du personnel hospitalier concerné(e)s aux discussions des comités de planification y sera exigée.
Recommandation 11
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé, par la tribune conjointe prévue à la recommandation 1, devraient travailler ensemble à l’élaboration et l’instauration d’un protocole commun régissant la communication concernant les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle, notamment l’envoi d’un avis aux Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle quand ces personnes sont admis(es) à l’hôpital et quand elles deviennent des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins ou des soins de longue durée, et pour soutenir la planification des transitions et des sorties d’hôpital.
Recommandation 12
Le protocole commun du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et du ministère de la Santé qui fait l’objet de la recommandation 11 devrait définir clairement les rôles et responsabilités des partenaires de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que les attentes à leur égard, et prévoir la participation des membres du personnel hospitalier concerné(e)s aux discussions des comités de planification.
265 Les ministères devraient encourager une meilleure communication entre les professionnel(le)s de la santé et ceux(celles) des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle autour des questions d’intérêt commun, par le biais d'un mécanisme approprié et structuré.
Recommandation 13
Le ministère de la Santé et le ministère de l’Enfance, des Services sociaux et communautaires devraient encourager une communication accrue entre les professionnel(le)s des secteurs de la santé et des services de développement sur les questions d’intérêt commun, par le biais d’un mécanisme approprié et structuré.
Échange efficace de l’information
266 Les préoccupations liées à la confidentialité des patient(e)s peuvent empêcher l’échange de renseignements importants entre le secteur de la santé et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Le MSESC et le MSAN doivent élaborer ensemble une méthode efficace pour recueillir et s’échanger les renseignements nécessaires à la planification concernant les personnes ayant une déficience intellectuelle qui reçoivent des soins de longue durée ou un autre niveau de soins.
267 Au sujet des comités de planification, un(e) fonctionnaire du MSESC nous a dit que même quand les partenaires de santé y participent, ils hésitent parfois à fournir les renseignements médicaux d’un(e) patient(e) pour des raisons de confidentialité. Il(elle) a expliqué que les SOPDI ne font pas partie du « cercle de soins » du MS, qui permet le libre échange d’information, et que le fait de ne pas révéler des renseignements médicaux importants aux comités de planification peut nuire aux efforts déployés pour assurer les transitions hors de l’hôpital.
268 Un(e) haut(e) responsable d’un hôpital a suggéré, afin de favoriser la communication entre les psychiatres dans les hôpitaux et les fournisseurs de soins communautaires, les gestionnaires de cas et les thérapeutes comportementalistes, de désigner les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comme dépositaires de renseignements sur la santé et de les autoriser à communiquer des renseignements cliniques via ConnexionOntario, le système provincial de tenue des dossiers médicaux. D’autres avec qui nous avons parlé croient que la solution idéale serait de créer un portail d’échange d’information réservé aux secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
269 Dans le protocole commun dont j’ai recommandé la mise sur pied, les ministères devraient prévoir une méthode d’échange des renseignements pertinents pour faciliter la planification de la sortie d’hôpital de chaque patient(e). Lorsque les partenaires de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ne mettent pas en commun les renseignements essentiels à la transition pour des motifs de confidentialité, les patient(e)s en subissent les conséquences. Je suis conscient que cette méthode pourrait nécessiter une solution législative.
Recommandation 14
Le protocole commun que doivent établir le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé selon la recommandation 11 devrait comprendre des dispositions expresses, concernant l’échange d’information sur les patient(e)s pour faciliter la planification de la transition des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Évaluer le problème à partir de chiffres incomplets
270 Il est difficile de savoir combien de personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario vivent dans une situation semblable à celle qu’ont vécue Jordan, Noah, Luc, Sean, Kevin, Jack et Anne à l’hôpital.
271 Le secteur hospitalier et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle recueillent tous deux des données sur les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont hospitalisées. Toutefois, ils utilisent chacun leur propre système d’information : le Système d’information sur les temps d’attente pour Santé Ontario, et le Système d’information centralisé sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour les SOPDI. Or, ni l’un ni l’autre ne contient de données fiables et exhaustives sur cette population.
272 Sans données exactes et fiables, les ministères peuvent difficilement s’appuyer sur les données pour s’attaquer aux facteurs contribuant à l’hospitalisation indue des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et si les SOPDI n’ont pas de données exactes et à jour sur ces personnes, celles-ci peuvent se voir privées des services nécessaires et voir leur séjour à l’hôpital se prolonger.
Système d’information sur les temps d’attente
273 Le Système d’information sur les temps d’attente de Santé Ontario est une base de données Web qui contient des renseignements et des statistiques concernant les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins.
274 Le système pose plusieurs limites à la consignation de renseignements sur les personnes ayant une déficience intellectuelle. Quand une personne a des « besoins liés à une déficience intellectuelle » qui entravent sa transition hors de l’hôpital, il faut l’indiquer dans le champ « Specialized Needs and Supports » (besoins spéciaux et soutiens spécialisés). Or, ce champ est sous-utilisé par le personnel chargé de saisir les données. Le personnel hospitalier avec qui nous avons parlé croit qu’il est « très probable » que le nombre de patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui nécessitent un autre niveau de soins soit sous-déclaré.
275 Ce problème pourrait s’expliquer par le fait que les médecins responsables de désigner un(e) patient(e) comme nécessitant un autre niveau de soins ne savent pas toujours que la personne a une déficience intellectuelle. Par exemple, le personnel hospitalier a ignoré la déficience intellectuelle de Jack pendant près de cinq ans.
276 Par ailleurs, le personnel hospitalier voit parfois la déficience intellectuelle non pas comme un obstacle à la sortie de l’hôpital, mais plutôt comme un problème de ressources dans la collectivité. Le personnel hospitalier et les clinicien(ne)s peuvent ignorer l’importance de déclarer ces renseignements si ceux-ci ne se rapportent pas directement aux soins prodigués. De plus, le champ sur les besoins spéciaux et les soutiens spécialisés n’est pas obligatoire.
277 La grande diversité des pratiques des médecins et des hôpitaux quand il leur faut désigner un(e) patient(e) nécessitant un autre niveau de soins est un autre facteur majeur influençant la fiabilité des données sur les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle. Par exemple, ni Noah ni Luc n’avaient reçu officiellement cette désignation, même si les clinicien(ne)s savaient que l’hôpital n’était pas un milieu adéquat pour eux.
278 Dans le cas de Jordan, plus de sept mois se sont écoulés avant que l’hôpital ne le désigne comme un patient nécessitant un autre niveau de soins. Le personnel hospitalier convenait qu’il n’avait pas besoin de soins hospitaliers à son admission, mais estimait que la désignation de patient nécessitant un autre niveau de soins aurait des conséquences négatives. Notamment, si son état avait été jugé « stable », il aurait pu ne pas avoir accès à une thérapie comportementale d’un organisme privé. Le temps écoulé avant qu’il reçoive cette désignation a joué sur le degré d’urgence accordé à son dossier par les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. D’après le personnel d’un organisme de services travaillant avec Jordan, c’est seulement une fois la désignation officiellement accordée que les SOPDI ont augmenté le niveau de priorité de Jordan et effectué une planification plus détaillée afin de lui fournir des services et du soutien.
279 Le personnel de Santé Ontario sait que le champ sur les besoins spéciaux et les soutiens spécialisés est sous-utilisé et que les pratiques de désignation des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins sont diverses. Le guide de référence sur l’accès à un autre niveau de soins publié par Santé Ontario explique les champs dans le système, et le personnel nous a dit s’entretenir régulièrement avec les hôpitaux pour les encourager à déclarer les personnes ayant une déficience intellectuelle. Cependant, comme le personnel du MSAN l’a expliqué, de nombreuses priorités concurrentes font obstacle à la saisie de ces renseignements, et il n’y a pas de directives officielles sur l’importance de signaler l’hospitalisation d’une personne ayant une déficience intellectuelle. Des fonctionnaires ont avancé que les données pourraient gagner en fiabilité si l’on faisait plus d’efforts de formation et d’information et que l’on rendait obligatoire le champ sur les besoins spéciaux et les soutiens spécialisés dans le Système d’information sur les temps d’attente.
280 Actuellement, le MSESC ne semble pas utiliser dans sa planification systémique les données figurant dans les rapports de Santé Ontario. Un(e) fonctionnaire d’un bureau régional de Santé Ontario nous a confié que les données sur les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui nécessitent un autre niveau de soins ne « disaient pas grand-chose » et suscitaient plus de questions que de réponses parce que les personnes ayant une déficience intellectuelle, ainsi que leurs troubles de santé et leurs besoins, ne sont pas identifiés clairement.
Système d’information centralisé sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
281 Pour faire le suivi des renseignements sur les personnes inscrites aux services, les SOPDI utilisent le Système d’information centralisé sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils comptent sur les organismes de services, la personne, les membres de la famille, les aidant(e)s et l’hôpital pour être avisés de l’hospitalisation d’une personne ayant une déficience intellectuelle. Il leur faut être avisés rapidement, car les circonstances de la personne entrent en compte dans son niveau de priorité, qui détermine si oui ou non elle obtiendra certains services, et à quel moment le cas échéant.
282 Différents facteurs influent sur l’exactitude des renseignements détenus par les SOPDI. Des fonctionnaires du MSESC avec qui nous avons parlé nous ont dit que l’absence d’exigences ou de procédure officielle obligeant les hôpitaux à communiquer avec les SOPDI était problématique, et qu’il serait utile que les hôpitaux aient des politiques ou des pratiques écrites à suivre pour améliorer la communication et assurer la consignation du nombre de patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins. Quelques fonctionnaires du MSAN et de Santé Ontario ont signalé une hésitation à alourdir le « fardeau de déclaration » du personnel hospitalier, en particulier celui des petits hôpitaux. Toutefois, ces derniers étant plus susceptibles de manquer de ressources pour aider les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle, il serait avantageux pour eux d’aviser rapidement les SOPDI afin d’assurer des services de soutien.
283 Quand les SOPDI apprennent qu’une personne ayant une déficience intellectuelle est hospitalisée faute de services répondant à leurs besoins dans la collectivité, ils ne peuvent pas indiquer dans leur système si cette personne nécessite un autre niveau de soins ou est hébergée inadéquatement; il n’y a aucun paramètre ni aucun champ le permettant. D’ailleurs, il n’y a aucune définition claire de l’expression « hébergé(e) inadéquatement ».
284 En 2017, le MSESC a rédigé une définition provisoire de ce terme, qui a été peaufinée en 2019. Cependant, il ne l’a jamais adoptée. Trois ans plus tard, des haut(e)s responsables des SOPDI ont de nouveau signalé au Ministère que l’absence de définition entraînait des lacunes dans la consignation des personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont hospitalisées.
285 Conscients des limites du Système d’information centralisé sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, certains bureaux des SOPDI tiennent manuellement une liste des personnes nécessitant un autre niveau de soins. Encore là, le personnel de ces bureaux avec qui nous avons parlé a admis que ces listes ne sont pas toujours à jour.
286 D’après des documents que nous avons examinés, le MSESC a envisagé au moment de concevoir le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic de dresser un « plan d’amélioration de la qualité des données » sur les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins et, à nouveau, d’adopter une définition fonctionnelle de personne « hébergée inadéquatement ». Toutefois, le personnel ministériel a plutôt décidé aux fins du projet de communiquer directement avec les hôpitaux afin d’identifier les personnes hospitalisées admissibles.
Manque d’information
287 L’une des recommandations du rapport Dans l’impasse portait spécifiquement sur la nécessité de mieux comprendre l’hospitalisation des personnes ayant une déficience intellectuelle : il s’agissait d’obtenir régulièrement des renseignements des hôpitaux de la province[68]. Le ministère des Services sociaux et communautaires de l’époque a répondu en disant que pour des motifs de confidentialité, il était impossible d’obtenir des renseignements sur les personnes hospitalisées sans le consentement de celles-ci.
288 Durant leur projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, les deux ministères ont essayé de contourner la chose. Par exemple, le personnel de Santé Ontario et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ont communiqué directement avec les hôpitaux pour s’informer sur les personnes admissibles. Malgré cela, ils ont quand même rencontré des obstacles relatifs à la confidentialité des patient(e)s.
289 Pendant cette enquête, des fonctionnaires du MSESC nous ont dit que la réforme des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle envisagée dans le document En quête d’appartenance allait comprendre « une quelconque forme » de changements dans les technologies de l’information une fois que le gouvernement aurait pris les décisions de fond nécessaires. Ils(elles) ont ajouté que les plans pour améliorer la qualité des données avaient été suspendus en raison de la réforme en cours et de « contraintes de ressources ». Ils(elles) ont expliqué que les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle « ne comptent pas parmi les premiers programmes à revoir en ce qui concerne la plateforme de données », et aucune échéance n’a été établie relativement à de tels travaux.
Relier les données : arguments en faveur d’un système intégré
290 Durant nos entretiens, les haut(e)s fonctionnaires des deux ministères étaient invariablement d’accord qu’il fallait de meilleures données pour comprendre et aider plus efficacement ces patient(e)s, et pour orienter les décisions de financement des services et des stratégies. Un(e) haut(e) fonctionnaire du MSAN travaillant sur le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic a fait remarquer que « l’on se retrouvera à jouer à la chaise musicale » si les ministères ne collectent pas des données fiables propres à soutenir les efforts déployés à l’échelle du système pour prévenir les cas de patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins. Il(elle) a ajouté que les ministères doivent s’employer à mieux définir les données requises, puis les recueillir.
291 Le MSAN a préparé un plan de mobilisation des hôpitaux et examiné les programmes hospitaliers pour les personnes à diagnostic mixte afin de colliger de l’information sur les personnes qui restent à l’hôpital parce qu’elles n’ont pas d’options dans la collectivité. Il a aussi demandé à l’Institute for Clinical Evaluative Sciences et au Centre de toxicomanie et de santé mentale de dégager les tendances chez les patient(e)s de longue durée occupant un lit affecté aux soins de santé mentale qui ont une déficience intellectuelle. L’étude porte sur les hospitalisations de longue durée plutôt que sur les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins parce que ce n’est pas tout le monde qui a la désignation officielle.
292 D’après les conclusions de l’étude, en date de septembre 2023, 555 patient(e)s ayant une déficience intellectuelle occupaient un lit affecté aux soins de santé mentale depuis plus d’un an. Cela représentait 28 % de tous(tes) les patient(e)s de longue durée ayant un trouble de santé mentale[69]. Cependant, nous savons que les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent se retrouver à l’hôpital ailleurs qu’à l’unité de santé mentale, et donc le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.
293 Les renseignements réunis grâce à cette étude s’avéreront utiles pour la planification, mais il reste qu’il faudra continuellement travailler à recueillir des données suffisantes et plus détaillées pour que les ministères puissent surveiller les tendances et assurer une meilleure planification des services de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Des données fiables sur les tendances des hospitalisations seront également utiles pour déterminer si les démarches visant à prévenir les hospitalisations indues fonctionnent ou nécessitent des ajustements.
294 À l’échelle de la personne, il doit exister entre les hôpitaux et les SOPDI un système de déclaration plus fiable et exact pour qu’aucun cas ne soit laissé de côté et que les gens puissent être priorisés et obtenir les services nécessaires en fonction de leur situation. Un(e) haut(e) responsable des SOPDI a expliqué qu’il est essentiel de communiquer avec les SOPDI quand quelqu’un demeure à l’hôpital en attendant des services adéquats.
295 Il est impératif que les ministères mettent au point ensemble une méthode de collecte et d’échange de renseignements exacts et exhaustifs sur les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui sont en séjour de longue durée et nécessitent un autre niveau de soins. Cette pratique facilitera la planification individuelle et systémique, dans l’objectif de renverser la tendance que suivent les hôpitaux en servant de lieu d’hébergement par défaut pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes.
296 S’il leur est possible de modifier leurs systèmes d’information respectifs et leurs pratiques d’échange de renseignements, compte tenu des limites et des différentes raisons d’être de ces systèmes, les ministères devraient envisager d’élaborer un nouveau modèle de système d’information intégré qui servira spécifiquement à consigner les renseignements sur les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle. Ils devraient aussi explorer des mécanismes propres pour répondre aux problèmes de confidentialité qui pourraient nuire à l’échange d’information entre le secteur hospitalier et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils devraient consulter les hôpitaux, les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en vue de discuter les obstacles liés à la confidentialité, et envisager une réponse législative au besoin.
Recommandation 15
Pour faciliter la planification, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient collaborer pour élaborer un modèle efficace de collecte et d’échange d’information exacte et actuelle sur les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui sont en séjour de longue durée et nécessitent un autre niveau de soins.
Recommandation 16
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient consulter le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée pour explorer des mécanismes propres pour répondre aux problèmes de confidentialité des patient(e)s qui nuisent à l’échange de l’information nécessaire entre le secteur hospitalier et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
Problèmes de dotation en personnel
297 Dans le document En quête d’appartenance, la vision gouvernementale d’une réforme des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, l’un des piliers est la croissance et la stabilisation d’un effectif compétent, diversifié et professionnel.
298 Nous avons entendu à maintes reprises des fonctionnaires du MSESC et des responsables des organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle affirmer que la transition des patient(e)s de longue durée dans des logements avec services de soutien appropriés dans la collectivité est entravée par la pénurie de personnel et les difficultés à recruter et à retenir du personnel compétent. Dans le cas de Sean, l’organisme de services qui avait essayé de lui obtenir un ratio en personnel de soutien de trois pour un en milieu rural avait assisté à des salons de l’emploi, organisé ses propres salons professionnels, communiqué avec des collèges et des programmes d’agent(e)s d’aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour offrir des stages, essayé de nouvelles plateformes d’embauche en ligne, et même réduit ses critères d’embauche et ses exigences relatives à l’expérience. Malgré tous ces efforts, l’organisme a été incapable de recruter assez de gens.
299 En 2018, l’Université Queen’s a publié une évaluation, financée par le Ministère, de la Stratégie des ressources humaines pour les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle de l’Ontario, une stratégie décennale datant de 2008[70]. Hormis les quelques tendances positives relevées, le rapport concluait que le recrutement demeurait l’un des problèmes les plus pressants signalés par les organismes de services dans un marché de l’emploi caractérisé par une pénurie de main-d’œuvre. En outre, l’examen de 2020 de KPMG sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle révélait que le Ministère n’avait [Traduction] « pas de stratégie unifiée » pour soutenir et faire croître la main-d’œuvre[71].
300 En 2023, l’Ontario Agencies Supporting Individuals with Special Needs, une organisation représentant plus de 190 organismes ontariens de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, a réclamé une stratégie complète de dotation en personnel pour le secteur ainsi que les fonds afférents[72]. Elle a affirmé que cette démarche serait « capitale pour concrétiser la vision établie dans En quête d’appartenance ». Plus récemment, un document produit en décembre 2024 par Community Living Ontario et l’Ontario Agencies Supporting Individuals with Special Needs indiquait que les organismes de services dépendant des agent(e)s d’aide font face à [Traduction] « une pénurie de personnel immédiate et continue ».
301 Les organismes de services nous ont dit qu’il n’y a pas assez de personnes détenant un diplôme d’agent(e) d’aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour combler la demande en personnel de soutien compétent. Certains ont commencé à embaucher des gens sous-qualifiés et à donner de la formation additionnelle sur le terrain. D’après un(e) professionnel(le) des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, les organismes de services n’ont souvent pas assez de ressources pour bien payer leur personnel et lui offrir toute la formation requise sur l’aide aux personnes ayant des besoins élevés. Un organisme de plus grande taille nous a dit qu’il avait réussi à renforcer sa capacité interne en donnant à son personnel de la formation en intervention comportementale, mais que ce n’était pas tous les organismes qui en avaient les moyens. Il a avancé qu’un investissement du Ministère dans ce type de formation pourrait aider à renforcer les compétences et la confiance du personnel affecté aux personnes ayant des besoins complexes.
302 Dans le cadre du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, le MSESC a élaboré avec des partenaires communautaires une série de cours de microcertification visant à renforcer la capacité du personnel de soutien auprès des adultes à diagnostic mixte qui quittent un lit affecté à un autre niveau de soins. Cependant, en date de janvier 2025, un peu moins de 200 personnes avaient participé ou s’étaient inscrit(e)s aux cours, dans un bassin de plus de 23 000 personnes à temps plein.
303 Les organismes de services nous ont expliqué que la pandémie de COVID-19 avait exacerbé la pénurie de personnel et les problèmes de recrutement, beaucoup de professionnel(le)s des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ayant changé de carrière. Un organisme nous a dit qu’il avait deux foyers vides à cause du manque de personnel et 32 postes à temps plein à combler. Un(e) fonctionnaire d’un bureau régional a raconté ce qui suit :
J’ai vu un énorme ralentissement ces dernières années dans la capacité à garder assez de personnel juste pour maintenir les services. La pandémie a vraiment fait des ravages. Les gens du secteur sont partis… des personnes employées depuis 20, 30 ans sont parties. Elles étaient tout simplement épuisées. Elles en avaient assez.
304 Le MSESC a pris des mesures additionnelles, en partenariat avec le Réseau provincial des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, pour s’attaquer aux problèmes de recrutement dans le secteur. Notamment, un document ministériel de mars 2023[73] mentionnait trois nouvelles initiatives visant à soutenir le personnel des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle : une campagne de marketing axée sur le recrutement pour promouvoir les carrières dans le secteur, la modernisation des compétences de base des agent(e)s d’aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour assurer un soutien plus personnalisé et axé sur la personne, et un programme de formation en leadership. Un(e) haut(e) fonctionnaire a aussi prédit que les futures mesures d’intervention entourant la vision énoncée dans En quête d’appartenance impliqueraient de collaborer avec le secteur pour formuler des stratégies sur la main-d’œuvre, selon un processus décisionnel gouvernemental assorti d’un horizon de 10 ans. Entre-temps, différents organismes et comités de planification communautaires travaillent à la résolution des problèmes locaux liés au recrutement et à la rétention du personnel.
305 Jusqu’en 2019, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires recueillait auprès des organismes de services des données détaillées sur la dotation par le biais de rapports annuels. Cependant, quand le gouvernement a mis en place un nouveau système en 2020 (Paiements de transfert Ontario), les exigences ont été « drastiquement simplifiées » pour réduire le fardeau administratif des organismes de paiements de transfert, y compris ceux aux services des personnes ayant une déficience intellectuelle. D’après des documents internes, le Ministère n’avait alors plus les [Traduction] « données exhaustives et détaillées nécessaires pour effectuer la planification du secteur en matière de main-d’œuvre et pour éclairer les décisions concernant les programmes et les politiques ». De même, il ne pouvait [Traduction] « confirmer, prévoir ou gérer les pressions ou tendances du secteur en matière de main-d’œuvre » pour les organismes financés par lui[74].
306 En 2024, le MSESC a commencé à élaborer une stratégie relative aux données sur la main-d’œuvre en vue de combler le manque d’information. Un(e) fonctionnaire nous a dit que l’amélioration des données devait aboutir à la fin de l’exercice financier 2025-2026.
307 Malgré les efforts récents, les difficultés à recruter et à retenir du personnel compétent continuent de contrarier les tentatives d’aider les patient(e)s de longue durée à retourner dans la collectivité. Elles nuisent aussi aux objectifs de choix et d’inclusion fixés par le gouvernement dans son document En quête d’appartenance. Ce problème, qui mine le secteur depuis bien des années, s’est aggravé parallèlement à la croissance de la demande en logements en collectivité avec services de soutien. Il n’existe pas de solution rapide. Néanmoins, je recommande au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de poursuivre le travail afin de déterminer et d’étudier les causes à la source de la pénurie de personnel dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives et des stratégies concrètes et efficaces pour favoriser le recrutement et la rétention. Dans la poursuite de cet objectif, le Ministère devrait régulièrement faire la collecte et le suivi des renseignements pertinents. Il devrait aussi examiner les résultats de ses démarches et en rendre compte.
Recommandation 17
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait déterminer et étudier les causes à la source de la pénurie de personnel dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment en faisant la collecte et le suivi réguliers des renseignements pertinents sur le recrutement et la rétention.
Recommandation 18
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait collaborer avec le secteur pour élaborer et mettre en œuvre des initiatives et des stratégies concrètes et efficaces pour favoriser le recrutement et la rétention dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et en examiner les résultats et en rendre compte à mon Bureau semestriellement.
Manque de soutiens en français
308 Pour les personnes les plus vulnérables, dont celles ayant une déficience intellectuelle qui sont indûment hospitalisées, l’obtention de services dans leur langue peut agir grandement sur leur état de santé. Le Rapport annuel 2021-2022 de la Commissaire aux services en français faisait référence à une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne par 11 chercheur(euse)s au sujet de la concordance linguistique entre les patient(e)s et leurs médecins. Selon cette étude, les francophones qui reçoivent des soins dans leur langue sont « significativement moins susceptibles d’avoir une hospitalisation préjudiciable ou de décéder à l’hôpital [...] que les francophones ayant reçu des soins dans un contexte de discordance linguistique. En outre, la durée moyenne des hospitalisations a été de 7 % plus brève chez les francophones traités dans un contexte de concordance linguistique[75] ».
309 Au cours de notre enquête, des francophones nous ont décrit les conséquences négatives vécues par des personnes ayant une déficience intellectuelle qui n’avaient pas accès à des soutiens hospitaliers dans leur langue, et les obstacles additionnels rencontrés dans l’obtention de services en français dans la collectivité. La situation de Luc témoigne des répercussions adverses que peut causer le manque de services en français dans le secteur des soins de santé et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L’absence répétée de réponse aux besoins communicationnels de Luc a empiré les difficultés de celui-ci à l’hôpital, et le manque de services en français dans la collectivité a prolongé son séjour.
Capacités limitées en français
310 Dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, les organismes de services nécessitant du personnel bilingue ou francophone font face à d’importants problèmes de recrutement. Un(e) fonctionnaire d’un bureau régional du MSESC ayant travaillé de près avec des organismes pour aider Luc a admis qu’il est beaucoup plus ardu d’embaucher du personnel francophone.
311 Dans le cas de Luc, il est particulièrement difficile de trouver un organisme ayant le personnel nécessaire parlant français pour le soutenir pendant son hospitalisation. De même, sa transition hors de l’hôpital est freinée par le manque de personnel bilingue dans les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Les organismes qui envisageaient de servir Luc, y compris ceux siégeant et aux comités de planification français, et aux comités de planification anglais, n’étaient pas convaincus de pouvoir trouver assez de personnel pour lui offrir le ratio requis de trois pour un. La nécessité d’avoir assez de personnel francophone ou bilingue aggrave la situation.
312 L’organisme de services qui s’occupait initialement de la planification pour Luc était le seul organisme financé par le Ministère dans la province à offrir des services exclusivement en français. Il y avait deux autres foyers dans la région qui offraient des services bilingues ou en français, mais ceux-là n’avaient pas les capacités nécessaires ou ne pouvaient pas accueillir les personnes aux besoins complexes.
313 Un autre organisme doté de personnel parlant français s’est proposé et pourrait être en mesure de créer un plan de transition pour Luc, mais le projet en est à ses toutes premières phases. Au moment de rédiger le présent rapport, Luc est toujours à l’hôpital.
314 Luc n’est pas le seul à être dans cette situation. Les organismes de services avec qui nous avons parlé ont rapporté d’autres cas de francophones ayant une déficience intellectuelle qui sont hospitalisé(e)s et qui doivent accepter l’aide d’organismes ne pouvant les servir en français. Ils nous ont dit que certain(e)s patient(e)s avaient dû quitter leur région afin de trouver un logement avec services de soutien. Un(e) fonctionnaire des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle a fait la remarque suivante :
[P]our pouvoir sortir de l’hôpital, même si leur famille et leur communauté sont ici, ces personnes ont dû partir, hors de leur région, pour trouver un chez-soi. Et cela non plus n’est pas juste…
315 Le personnel ministériel nous a dit que, dans le cadre de son rôle de surveillance, il travaille avec les organismes à l’élaboration de plans d’amélioration de la qualité, y compris des plans concernant le français, afin que ces organismes développent leur capacité à fournir des services en français. Néanmoins, il a aussi reconnu que la mise en œuvre de ces plans prend plusieurs années parce que les organismes, ne pouvant pas créer de nouveaux postes ou renforcer leurs capacités sans fonds additionnels, doivent attendre que des membres du personnel unilingue quittent leur emploi pour les remplacer par du personnel bilingue ou francophone.
316 Dans le cadre de la planification afférente à la vision En quête d’appartenance, le MSESC a consulté des groupes et des parties prenantes francophones et sollicité leur rétroaction sur divers sujets, notamment les logements avec services de soutien et les personnes aux besoins complexes. Toutefois, les fonctionnaires nous ont dit en être toujours à la planification dans les démarches pour combler les lacunes dans les services en français qui ont été relevées lors des consultations.
317 Des fonctionnaires du MSESC nous ont indiqué que la région de l’Est compte 43 % de la population francophone de l’Ontario, ajoutant que le Ministère a fait des investissements visant à renforcer les capacités de services en français dans la région au fil des années. Cependant, cet objectif est entravé par le fait que la planification pluriannuelle des services de soutien ne prévoit pas d’investissement ciblant la population francophone, et que les fonds sont alloués suivant la priorisation des personnes. Les fonctionnaires ont aussi expliqué que, même si le système de données du SOPDI peut enregistrer des informations sur la préférence linguistique d’une personne, les limitations de sa capacité de production de rapports rendent difficile pour les bureaux régionaux du ministère de surveiller combien de personnes inscrites au registre des services de soutien à la vie autonome ont besoin de services en français.
318 Le MSESC devrait mettre au point une méthode plus efficace pour comptabiliser le nombre de personnes inscrites auprès des SOPDI qui ont besoin de services de soutien en français. J’ai déjà recommandé que le MSAN et le MSESC travaillent ensemble pour concevoir une méthode efficace de collecte et d’échange de renseignements de planification sur les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui sont en séjour de longue durée et nécessitent un autre niveau de soins. Dans le cadre de ce travail collaboratif, les ministères devraient collaborer avec les partenaires du système pour développer des méthodes de comptabiliser le nombre de patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et recevant des soins de longue durée qui sont francophones.
319 Le MSESC devrait utiliser les renseignements recueillis sur les besoins en matière de services en français pour concevoir et mettre en œuvre des initiatives et des stratégies visant à accroître l’effectif parlant français dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour orienter la planification du système en général.
Recommandation 19
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait mettre au point une méthode plus efficace pour comptabiliser le nombre de personnes inscrites auprès des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont besoin de services de soutien en français.
Recommandation 20
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient collaborer avec les partenaires du système pour développer prévoir des méthodes pour consigner le nombre de patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui sont francophones ainsi que la durée de leur hospitalisation.
Recommandation 21
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait utiliser les renseignements recueillis sur les besoins en matière de services en français pour concevoir et mettre en œuvre des initiatives et des stratégies visant à accroître l’effectif parlant français dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour orienter la planification du système en général.
Soutiens cliniques pour les francophones
320 Non seulement il est difficile de trouver des agent(e)s d’aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui parlent français, mais il est aussi difficile de trouver des spécialistes cliniques bilingues, comme des psychologues et des psychiatres, qui peuvent servir les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont francophones.
321 La Ressource de services spécialisés en langue française (la « Ressource ») fait partie des réseaux communautaires de soins spécialisés. Elle soutient des initiatives visant à améliorer dans toute la province l’accès à des services cliniques spécialisés en français. Elle aide les organismes de services et les professionnel(le)s à aiguiller les personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que des troubles de santé mentale ou de comportement ou d’autres besoins complexes vers des ressources cliniques en français. Cependant, ces ressources demeurent limitées.
322 Le MSAN sait qu’il existe des problèmes d’accès aux services en français. Des fonctionnaires nous ont dit travailler à améliorer la situation, entre autres par des moyens technologiques comme la télésanté mentale. Ils(elles) ont mentionné que des investissements ont été faits dans les soutiens en santé mentale en français dans le cadre de la stratégie « Vers le mieux-être » du Ministère, mais que ces soutiens ne sont pas spécifiquement destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
323 Le MSAN et le MSESC devraient travailler ensemble, par la tribune conjointe dont j’ai recommandé la création, pour élaborer et mettre en œuvre des initiatives et des stratégies visant à accroître l’offre de soutiens cliniques pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont francophones et à faciliter la transition de ces personnes de l’hôpital à la collectivité.
Recommandation 22
Le ministère de la Santé et le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devraient travailler ensemble pour identifier et élaborer des initiatives et des stratégies visant à accroître l’offre de soutiens cliniques pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont francophones et à faciliter la transition de ces personnes de l’hôpital à la collectivité.
Opinion
324 Les membres particulièrement vulnérables de notre société ont des droits qu’il nous faut respecter et une dignité qu’il nous faut protéger; ils(elles) méritent des conditions humaines et de la compassion. Les histoires de Jordan, Jack, Luc, Noah, Sean, Kevin et Anne – et de bien d’autres personnes dans des situations semblables – sont marquées par la privation et le déclin, conséquences d’une hospitalisation prolongée et indue.
325 Les expériences de ces sept personnes racontées dans le présent rapport tranchent lamentablement avec les visées de la Loi sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et avec la vision En quête d’appartenance du MSESC, qui cherche à donner aux personnes les moyens de faire leurs propres choix et d’être autonomes et à les faire bénéficier de soutiens équitables, pérennes et gérés par la personne.
326 Un nombre préoccupant de personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes continuent de souffrir pendant des périodes inutilement longues dans les hôpitaux et les établissements de soins psychiatriques de l’Ontario. Les hôpitaux sont devenus le milieu de vie par défaut de bien des personnes parmi celles ayant les besoins les plus complexes, dans un système dont les capacités sont loin de suffire pour leur donner les services et soutiens intensifs nécessaires dans la collectivité. C’est tout simplement inacceptable.
327 Abandonnées dans des milieux institutionnels qui n’ont pas été conçus pour répondre à leurs besoins, certaines de ces personnes deviennent désorientées, frustrées et incontrôlables, ce qui entraîne le recours systématique à des contentions chimiques et physiques. Malgré les efforts du personnel des soins de santé et des services sociaux, beaucoup se retrouvent dans des conditions déplorables et inacceptables. Leur hospitalisation prolongée entraîne souvent une régression et la perte de compétences et d’aptitudes durement acquises. Plus l’hospitalisation est longue, plus il est difficile de trouver un organisme de services disposé à aider la personne dans sa transition dans la collectivité. Les séjours prolongés font aussi augmenter les coûts des logements avec services de soutien dans la collectivité.
328 Il est démoralisant de constater les faibles progrès réalisés depuis que j’ai publié mon rapport Dans l’impasse en août 2016. La présente enquête nous a appris qu’en 2017 et en 2018, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires avait activement préparé une stratégie, collaborait en vue de créer un cadre pour les logements avec services de soutien et planifiait des initiatives au service des personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont indûment hébergées dans des milieux comme les hôpitaux. Cependant, ces plans ont été suspendus et n’ont jamais repris.
329 La pénurie chronique de structures de soutien et de logements adaptés adéquats, en particulier pour les personnes aux besoins complexes, ne montre aucun signe de résorption. On constate peu de progrès dans la planification proactive à long terme du système, que l’on a remplacée par des projets et initiatives ponctuels et de courte durée. Certes, le projet ministériel conjoint d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic a répondu à des besoins pressants pendant un bref moment, mais il permettait de ne traiter qu’un dossier à la fois, laissant le système dans le même état inacceptable qu’au départ.
330 Pendant des années, les équipes de recherche s’étant succédé ont souligné la nécessité d’améliorer la collaboration, la planification systémique, la coordination et l’intégration des services dans les secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Or, les deux systèmes demeurent divisés et cloisonnés.
331 Vu la hausse inquiétante du nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes qui nécessitent des soutiens, la situation ne fera que s’empirer. Le gouvernement a défini des objectifs ambitieux dans sa vision En quête d’appartenance, qui s’étend sur un horizon de 8 à 10 ans – mais ces objectifs ne pourront jamais se concrétiser sans changements rapides et réels.
332 Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires a pour tâche de surveiller le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, qui assure notamment la prestation de soutiens et de services aux « citoyen(ne)s vulnérables ». Toutefois, au cours de notre enquête, plusieurs fonctionnaires ont souligné que les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ne constituent pas un programme sans restriction. D’autres semblaient s’être résigné(e)s au caractère insurmontable du problème des ressources limitées face aux besoins de cette population. Je crains que ces attitudes reflètent un défaitisme enraciné qui, s’il persiste, menace d’engendrer complaisance et inaction. Étant à la barre du secteur, le MSESC devrait se faire le champion du changement. Il devrait tenter avec énergie de trouver des solutions à cette situation où les hôpitaux servent souvent de lieu d’hébergement par défaut pour les personnes ayant une déficience intellectuelle en situation de crise.
333 Depuis des années, le Ministère néglige de remédier efficacement à la situation des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui sont en séjour de longue durée. Il n’a pas fait de planification proactive pour combler le manque de logements avec services de soutien adéquats dans les collectivités, y compris pour les personnes nécessitant des soutiens et services en français. Il n’a pas veillé non plus à réunir des renseignements exacts en vue d’une planification systémique.
334 Le ministère de la Santé encadre le système de soins de santé de l’Ontario. Il est bien conscient des difficultés vécues par les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont indûment confinées à l’hôpital sans soutiens spécialisés adéquats, de même que des pressions causées par ces hospitalisations prolongées sur le personnel des soins de santé et des conséquences sur l’accès aux lits de soins actifs.
335 Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé ne se sont pas livrés à une collaboration efficace pour assurer l’échange de renseignements, la mise au point de pratiques de communication et la réalisation d’une planification systémique capable de faire cesser l’hospitalisation indue des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils n’ont pas non plus mis en place de trajectoires efficaces ni de soutiens intégrés pour permettre la transition des patient(e)s vers des conditions adéquates dans la collectivité, ce qui réduirait les répercussions des séjours à l’hôpital et le risque de réadmission. Par conséquent, je suis d’avis que la conduite des deux ministères est déraisonnable et erronée aux termes de la Loi sur l’ombudsman.
336 Mes recommandations visent à guider les deux ministères et à les aider à planifier, à élaborer une stratégie et à mettre en œuvre des projets et des initiatives conçus pour réduire le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle qui dépérissent dans les hôpitaux de l’Ontario. La situation actuelle a un prix humain énorme pour les personnes elles-mêmes, mais également pour leur famille. Elle fait aussi peser sur le système de santé un fardeau insoutenable, qui accentue les difficultés pour la main-d’œuvre des secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et limite l’accès aux rares lits de soins actifs. J’espère qu’en mettant en lumière l’histoire de ces sept personnes dont la vie a été mise sur pause pendant qu’elles étaient coincées à l’hôpital dans un état de dépérissement, ce rapport donnera lieu à la réforme et aux améliorations systémiques concrètes et durables longtemps attendues.
337 J’exhorte les deux ministères à collaborer de près et à se concerter dans leur examen du présent rapport et dans la réponse qu’ils y donneront. Je vais suivre de près leurs progrès dans l’application de mes recommandations.
Recommandation 23
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient présenter ensemble à mon Bureau un compte rendu des progrès communs réalisés dans l’application de mes recommandations 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 et 22, une première fois dans six mois, puis tous les six mois par la suite jusqu’à ce que je sois convaincu que des mesures adéquates ont été prises pour y donner suite.
Recommandation 24
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait présenter à mon Bureau un compte rendu des progrès réalisés dans l’application de mes recommandations 2, 3, 4, 17, 18, 19 et 21, une première fois dans six mois, puis tous les six mois par la suite jusqu’à ce que je sois convaincu que des mesures adéquates ont été prises pour y donner suite.
Recommandations
Compte tenu des résultats de cette enquête, je fais les recommandations suivantes :
Recommandation 1
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient immédiatement établir une tribune conjointe permanente pour amorcer une planification proactive du système pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. Cette tribune devrait collaborer avec tous les partenaires des services de développement et de santé nécessaires à une planification efficace. La tribune devrait entamer ses travaux dans les six mois suivant la parution de mon rapport et travailler de façon coopérative pour s’attaquer aux obstacles auxquels sont confronté(e)s les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes qui nécessitent un autre niveau de soins ou des soins de longue durée, afin qu’ils(elles) puissent faire la transition dans un logement avec services de soutien adéquat dans la collectivité. La tribune conjointe devrait faire rapport aux sous-ministres des deux ministères et devrait fournir un bilan semestriel de ses progrès à mon Bureau.
Recommandation 2
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait intégrer la planification et le financement des immobilisations à la planification proactive d’un système de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, afin d’établir une infrastructure communautaire adéquate et appropriée, répondant aux besoins de ces personnes, notamment celles ayant des besoins complexes.
Recommandation 3
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait intégrer la prévision financière des coûts des services des organismes et de la gestion des places vacantes à la planification proactive du système.
Recommandation 4
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait se doter d’un processus transparent pour la négociation des budgets pour répondre aux besoins accrus des personnes et des organismes de services dans le cadre de sa planification proactive du système. Ce processus devrait prévoir des critères d’admission et décisionnels clairement définis qui sont transmises à mon Bureau et diffusées dans tout le secteur.
Recommandation 5
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient travailler ensemble, par la tribune conjointe dont il est question dans la recommandation 1, pour définir et mettre en œuvre une stratégie intégrée et un cadre de soins approprié pour la prestation de services et de soutiens dans l’ensemble des secteurs des services de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin de prévenir les hospitalisations inutiles et de soutenir les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes à l’hôpital ainsi que pendant et après leur transition dans la communauté.
Recommandation 6
Par la tribune conjointe dont il est question dans la recommandation 1, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient viser à assurer aux patient(e)s ayant une déficience intellectuelle l’accès au soutien nécessaire à l’hôpital et à du soutien clinique pendant et après la transition vers la communauté.
Recommandation 7
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient se donner comme priorité de travailler ensemble pour mettre à jour, publier et mettre en œuvre la Directive stratégique conjointe pour la prestation de services communautaires de santé mentale et de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des troubles jumelés.
Recommandation 8
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient étendre l’application de la Directive stratégique conjointe pour la prestation de services communautaires de santé mentale et de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des troubles jumelés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes n’ayant pas reçu de diagnostic officiel en santé mentale.
Recommandation 9
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient publier sur leurs sites Web des renseignements pertinents, mis à jour annuellement, concernant le nombre de personnes sur les listes d’attente pour les logements supervisés financés par les ministères, les délais d’attente potentiels, le nombre de places vacantes annuelles et le nombre de personnes desservies par chaque type de logement supervisé financé.
Recommandation 10
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé, par la tribune conjointe dont il est question à la recommandation 1, devraient travailler ensemble à l’élaboration et à la mise en œuvre, pour le secteur de la santé, d’un programme permanent d’information et de formation axé sur la communication d’information concernant les ressources, les programmes et les processus des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à diagnostic mixte, afin de faciliter la planification de la transition des patient(e)s ayant une déficience intellectuelle hors de l’hôpital.
Recommandation 11
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé, par la tribune conjointe prévue à la recommandation 1, devraient travailler ensemble à l’élaboration et l’instauration d’un protocole commun régissant la communication concernant les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle, notamment l’envoi d’un avis aux Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle quand ces personnes sont admis(es) à l’hôpital et quand elles deviennent des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins ou des soins de longue durée, et pour soutenir la planification des transitions et des sorties d’hôpital.
Recommandation 12
Le protocole commun du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et du ministère de la Santé qui fait l’objet de la recommandation 11 devrait définir clairement les rôles et responsabilités des partenaires de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que les attentes à leur égard, et prévoir la participation des membres du personnel hospitalier concerné(e)s aux discussions des comités de planification.
Recommandation 13
Le ministère de la Santé et le ministère de l’Enfance, des Services sociaux et communautaires devraient encourager une communication accrue entre les professionnel(le)s des secteurs de la santé et des services de développement sur les questions d’intérêt commun, par le biais d’un mécanisme approprié et structuré.
Recommandation 14
Le protocole commun que doivent établir le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé selon la recommandation 11 devrait comprendre des dispositions expresses, concernant l’échange d’information sur les patient(e)s pour faciliter la planification de la transition des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Recommandation 15
Pour faciliter la planification, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient collaborer pour élaborer un modèle efficace de collecte et d’échange d’information exacte et actuelle sur les patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui sont en séjour de longue durée et nécessitent un autre niveau de soins.
Recommandation 16
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient consulter le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée pour explorer des mécanismes propres pour répondre aux problèmes de confidentialité des patient(e)s qui nuisent à l’échange de l’information nécessaire entre le secteur hospitalier et celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
Recommandation 17
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait déterminer et étudier les causes à la source de la pénurie de personnel dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment en faisant la collecte et le suivi réguliers des renseignements pertinents sur le recrutement et la rétention.
Recommandation 18
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait collaborer avec le secteur pour élaborer et mettre en œuvre des initiatives et des stratégies concrètes et efficaces pour favoriser le recrutement et la rétention dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et en examiner les résultats et en rendre compte à mon Bureau semestriellement.
Recommandation 19
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait mettre au point une méthode plus efficace pour comptabiliser le nombre de personnes inscrites auprès des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont besoin de services de soutien en français.
Recommandation 20
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient collaborer avec les partenaires du système pour développer prévoir des méthodes pour consigner le nombre de patient(e)s ayant une déficience intellectuelle qui sont francophones ainsi que la durée de leur hospitalisation.
Recommandation 21
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait utiliser les renseignements recueillis sur les besoins en matière de services en français pour concevoir et mettre en œuvre des initiatives et des stratégies visant à accroître l’effectif parlant français dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour orienter la planification du système en général.
Recommandation 22
Le ministère de la Santé et le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devraient travailler ensemble pour identifier et élaborer des initiatives et des stratégies visant à accroître l’offre de soutiens cliniques pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont francophones et à faciliter la transition de ces personnes de l’hôpital à la collectivité.
Recommandation 23
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé devraient présenter ensemble à mon Bureau un compte rendu des progrès communs réalisés dans l’application de mes recommandations 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 et 22, une première fois dans six mois, puis tous les six mois par la suite jusqu’à ce que je sois convaincu que des mesures adéquates ont été prises pour y donner suite.
Recommandation 24
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires devrait présenter à mon Bureau un compte rendu des progrès réalisés dans l’application de mes recommandations 2, 3, 4, 17, 18, 19 et 21, une première fois dans six mois, puis tous les six mois par la suite jusqu’à ce que je sois convaincu que des mesures adéquates ont été prises pour y donner suite.
Réponses
338 J’ai donné au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et au ministère de la Santé l’occasion d’examiner mes conclusions préliminaires, mon opinion et mes recommandations, et d’y répondre. Leurs commentaires et suggestions ont été pris en compte avec soin lors de la préparation du présent rapport final.
339 Dans leur réponse conjointe, les ministères ont accepté toutes mes recommandations et ont confirmé leur engagement à collaborer avec mon Bureau et les partenaires du système afin d’améliorer la situation des personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. Les ministères ont reconnu la nécessité d’une approche coordonnée et durable pour la prestation de soins et de soutien dans les milieux appropriés.
340 Outre la reconnaissance de la nécessité d’une planification intégrée et d’une collaboration intersectorielle améliorée, les ministères se sont engagés à améliorer le partage et la communication des données. Ils ont décrit les mesures qu'ils ont prises à ce jour pour soutenir la transition des personnes hors de l'hôpital, notamment par le biais du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic. Ils ont également réaffirmé leur volonté de mettre en place un système davantage axé sur la personne afin de mieux répondre aux besoins et aux objectifs individuels. Dans leur réponse, les ministères reconnaissent que les améliorations nécessitent une approche multisectorielle, coordonnée et durable pour garantir que les personnes reçoivent le soutien approprié au bon endroit – une approche qui exigera un changement important par rapport à la situation actuelle à bien des égards.
341 Je suis encouragé par l’engagement des ministères à collaborer pour prévenir les hospitalisations inappropriées, déshumanisantes et prolongées décrites dans ce rapport. J’exhorte les ministères à adopter et à mettre en œuvre rapidement mes recommandations afin de rendre leurs services et leur planification plus proactifs et intégrés. Face à un système complexe, ces changements nécessiteront un engagement soutenu des deux ministères afin de permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle de vivre une vie sûre et épanouissante au sein de la communauté.
342 Je suivrai de près les progrès des ministères dans la mise en œuvre de mes recommandations et me réjouis de leur coopération continue avec mon Bureau.
_______________________
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
[1] Les noms dans le présent rapport ont été changés pour protéger la confidentialité des personnes nous ayant raconté leur histoire.
[2] Ombudsman Act (Re), 1970 CanLII 798 (AB KB), en ligne.
[3] Institute for Clinical and Evaluative Sciences et Centre de toxicomanie et de santé mentale, Programme de recherche sur l’accès aux soins de santé et la déficience intellectuelle, H-CARDD snapshot : Long-Stay Patients in Ontario Mental Health Beds with Developmental Disabilities, octobre 2024, en ligne.
[4] Pour en savoir plus sur l’histoire des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario, voir : Ombudsman Ontario, Dans l’impasse, 2016, en ligne.
[5] L’Ontario ferme les établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle, communiqué de l’Ontario (archivé), 31 mars 2009, en ligne.
[6] Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, L.R.O. 1990, chap. D.11 (abrogée le 1er juillet 2011).
[7] Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, chap. 4.
[8] Vision du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires en matière de services de développement, en ligne.
[9] Ombudsman Ontario, Dans l’impasse, 2016, en ligne.
[10] Votre santé : Plan pour des soins interconnectés et commodes, ontario.ca, en ligne.
[11] Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées offre un soutien au revenu pour les besoins de base et un logement aux adultes admissibles ayant un handicap. Le financement accordé dépend du revenu et de la situation de la personne. À compter du 1er juillet 2025, une personne célibataire peut recevoir jusqu’à 1 408 $ par mois pour ses besoins de base et son logement, en ligne.
[12] Les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent se voir accorder de 5 500 $ à 44 275 $ par année pour payer les services et soutiens nécessaires, par exemple, un(e) professionnel(le) de soutien direct, des services de relève et des programmes communautaires, en ligne.
[13] Site de Santé Ontario, en ligne.
[14] Loi de 2019 pour des soins interconnectés, L.O. 2019, chap. 5, annexe 1, art. 6.
[15] Santé Ontario, Alternate Level of Care (ALC) Reference Manual, version 3, 1er avril 2021, en ligne.
[16] Unité des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle du MSESC, Minister Briefing – Foundational Information, 12 avril 2023.
[17] Bureau de la responsabilisation financière de l’Ontario, ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires : Examen du plan de dépenses, 2024, p. 23, en ligne.
[18] Bureau du vérificateur général de l’Ontario, Rapport annuel 2016, « 3.07 Services de logement et de soutien pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale (en milieu communautaire) », en ligne.
[19] Addictions and Mental Health Ontario, Policy Recommendations for Mental Health and Addictions Supportive Housing in Ontario, février 2024, en ligne.
[20] Ganesan, K., Matte, A., Williams, A. R., Wilkie J., Chan., C., O’Connor, K., Addictions and Mental Health Ontario, Unlocking Solutions: Understanding and Addressing Ontario’s Mental Health and Addictions Supportive Housing Needs, 2025, en ligne.
[21] DD ALC Client Proposal Form, 27 octobre 2021, et DD ALC MOH et MCCSS Master List, novembre 2021.
[22] Community and Social Services – DS Residential Services (Adults), note de programme, 9 octobre 2018.
[23] MSESC, Developmental Services Reform Foundational Papers, Residential Services and Supports, 23 juillet 2019.
[24] Addictions and Mental Health Ontario, Policy Recommendations for Mental Health & Addictions Supportive Housing in Ontario, février 2024, en ligne.
[25] MSESC, Services aux adultes ayant une déficience intellectuelle, Minister Briefing – Foundational Information, avril 2023.
[26] 2022-23 MHA My Proposal Template, 9 septembre 2021; OO Overview DD ALC, présentation PowerPoint, 3 mai 2023.
[27] MSESC, Developmental Services Foundational Deck Minister Briefing, 12 avril 2023.
[28] Ombudsman Ontario, Dans l’impasse, 2016, p. 106, par. 291 et 292, en ligne.
[29] Ombudsman Ontario, Dans l’impasse, 2016, p. 145, par. 393, recommandation 54.
[30] Bureau de la responsabilisation financière de l’Ontario, ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires : Examen du plan de dépenses, 2024, en ligne.
[31] Dale Butterill, M.S.S, M.A.P., Elizabeth Lin, Ph. D., Janet Durbin, Ph. D., Yona Lunsky, Ph. D., Karen Urbanoski, Ph. D. (candidate), et Heather Soberman, M.A., Centre de toxicomanie et de santé mentale, From Hospital to Home: The Transitioning of Alternate Level of Care and Long-stay Mental Health Clients, septembre 2009.
[32] KPMG, Provincial Review of Dual Diagnosis Programs: Final Report, 5 octobre 2012.
[33] Groupe de travail sur le logement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, Generating Ideas and Enabling Action: Addressing the Housing Crisis Confronting Ontario Adults with Developmental Disabilities, rapport final 2018, en ligne.
[34] Lin E., Balogh R.S., Durbin A., Holder L., Gupta N., Volpe T., Isaacs B. J., Weiss J. A., Lunsky Y., ICES, Addressing Gaps in the Health Care Services Used by Adults with Developmental Disabilities in Ontario, Toronto (Ontario), 2019.
[35] Centre de toxicomanie et de santé mentale, Housing and Mental Health Policy Framework, février 2022, en ligne.
[36] Selick, A., Morris, S., Volpe, T., et Lunsky, Y., Centre de toxicomanie et de santé mentale, Supporting alternate level of care (ALC) patients with a dual diagnosis to transition from hospital to home: Practice guidance, Toronto (Ontario), 2023, en ligne.
[37] Ombudsman Ontario, Dans l’impasse, 2016, p. 21, par. 58, en ligne.
[38] Cadre stratégique du logement avec services de soutien de l’Ontario, mars 2017, en ligne.
[39] MSESC, Housing and Supports for Adults with a Developmental Disability DS Housing Strategy, 17 et 18 avril 2018.
[40] MCCSS Expenditure Management Strategy, note de service du sous-ministre adjoint au Comité de gestion du Ministère, 22 août 2018.
[41] Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, note d’information à la ministre, septembre 2018.
[42] Groupe de travail sur le logement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, Generating Ideas and Enabling Action: Addressing the Housing Crisis Confronting Ontario Adults with Developmental Disabilities, rapport final 2018, en ligne.
[43] MSESC, Developmental Services Reform Foundational Papers: Residential Services and Supports, juillet 2019.
[44] KPMG, Developmental Services: Opportunities for a Sustainable Delivery Model, version provisiore, 6 février 2020.
[45] MSESC, Developmental Services Housing Deck, Appendix E, 17 août 2022.
[46] MSESC, DS Housing Initiatives Review – Director’s Discussion, présentation PowerPoint, 18 août 2022.
[47] Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, note d’information, 19 novembre 2020.
[48] Stratégie pour la planification pluriannuelle des services résidentiels 2021 2022, Regional Directors & Community Program Managers, présentation PowerPoint, document de discussion provisoire, 5 mars 2021.
[49] Shortt (Re), 2020 ONCA 651 (CanLII), en ligne.
[50] Dual Diagnosis Alternate Level of Care - Action Plan, présentation PowerPoint, février 2023.
[51] MSESC, 2023-24 Strategic Decisions Template: Social Services Infrastructure Strategy Request.
[52] MSESC, Developmental Services Reform Foundational Papers: Residential Services and Supports, juillet 2019.
[53] Cathexis Consulting Inc., Cross-Sector Complex Care Model: Evaluation Report: York Region Pilot, 24 avril 2017.
[54] Lin E., Balogh R. S., Durbin A., Holder L., Gupta N., Volpe T., Isaacs B. J., Weiss J. A., Lunsky Y., ICES, Addressing Gaps in the Health Care Services Used by Adults with Developmental Disabilities in Ontario, Toronto (Ontario), 2019. ISBN: 978-1-926850-85-6, en ligne.
[55] Selick, A., Morris, S., Volpe, T. et Lunsky, Y., Centre de toxicomanie et de santé mentale, Supporting alternate level of care (ALC) patients with a dual diagnosis to transition from hospital to home: Practice Guidance, Toronto (Ontario), 2023, en ligne.
[56] Programme de réadaptation et de soutien transitoire au logement pour les personnes faisant l'objet d'un double diagnostic (PRSTL-DD) – Ce programme est destiné aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou ayant reçu un diagnostic mixte qui sont hospitalisées dans une unité de psychiatrie médicolégale aux termes d’une décision de la Commission ontarienne d'examen. Ces personnes ont été jugées non criminellement responsables ou inaptes à subir un procès à la suite d’un conflit de lois. Les foyers de soins communautaires font partie d’un programme de transition visant à enseigner ainsi qu’à soutenir et à développer les aptitudes à la vie quotidienne de ces personnes pour qu’elles puissent redevenir des citoyen(ne)s participant à la vie en société.
[57] Stratégie pour la planification pluriannuelle des services résidentiels 2022-2023 à 2024-2025 pour les partenaires de planification des SPDI.
[58] KPMG, Developmental Services: Opportunities for a Sustainable Delivery Model (rapport provisoire), 6 février 2020.
[59] MSESC, Developmental Services Foundation Briefing, janvier 2021.
[60] MSESC, Health Access Barriers (DS Reform) (présentation PowerPoint), 28 septembre 2021.
[61] Ministère de la Santé et des Soins de longue durée et ministère des Services sociaux et communautaires, Directive stratégique conjointe pour la prestation de services communautaires de santé mentale et de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des troubles jumelés, décembre 2008, en ligne.
[62] KPMG, Provincial Review of Dual Diagnosis Programs: Final Report, 5 octobre 2012.
[63] Improving Linkages Between the Health and Developmental Services Sectors, présentation des gestionnaires sur les soins centrés sur la patientèle, 13 novembre 2018.
[64] Direction des politiques de soutien communautaire, MSESC, et Direction de la santé mentale et des dépendances, MSSLD, Dual Diagnosis Framework: Proposed Next Steps, novembre 2018.
[65] Direction des politiques de soutien communautaire, MSESC et Direction de la santé mentale et des dépendances, MSSLD, Dual Diagnosis Framework, Proposed Next Steps (présentation PowerPoint), novembre 2018.
[66] Selick, A., Morris, S., Volpe, T., et Lunsky, Y., Supporting alternate level of care (ALC) patients with a dual diagnosis to transition from hospital to home: Practice guidance, Toronto (Ontario), 2023, Centre de toxicomanie et de santé mentale.
[67] Réseau provincial des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, A Call to Action for Fundamental Cross-Sectoral Change, Advancing access, equity, and improved health outcomes for persons living with intellectual and developmental disabilities, exposé de position du groupe de travail Health Strategy and Engagement, septembre 2023, en ligne.
[68] Ombudsman Ontario, Dans l’impasse, 2016, recommandation 15, en ligne.
[69] Health Care Access Research and Developmental Disabilities, Long-Stay Patients in Ontario Mental Health Beds with Developmental Disabilities, octobre 2024, en ligne (en anglais).
[70] Programme des relations de travail de l’Université Queen’s, Robert Hickey, Ph. D., Assessing the impacts of the ten-year DSHR Strategy and informing continued efforts to advance workforce development and enhance HR practices in Ontario’s developmental services sector, rapport d’évaluation sur la Stratégie des ressources humaines pour les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle : rapport sommaire.
[71] KPMG, Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, Opportunities for a Sustainable Delivery Model, version provisoire, ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, 6 février 2020.
[72] Ontario Agencies Supporting Individuals with Special Needs (OASIS), 2023 Questions et réponses, en ligne.
[73] MSESC, Workforce Strategy Briefing Deck: Confidential Advice, mise à jour du 28 novembre 2023.
[74] MSESC, Workforce Data Strategy Status Update for ADMs, 17 janvier 2025.
[75] Emily Seale, Michael Reaume, Ricardo Batista, Anan Bader Eddeen, Rhiannon Roberts, Emily Rhodes, Daniel I. McIsaac, Claire E. Kendall, Manish M. Sood, Denis Prud’homme et Peter Tanuseputro, JAMC, vol. 194, no 26, 11 juillet 2022, E899-E908; DOI, en ligne.